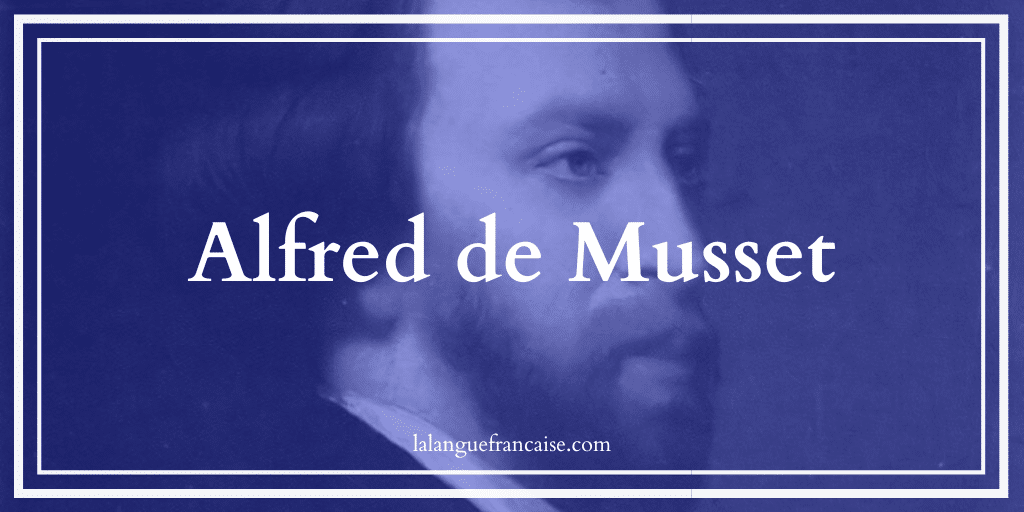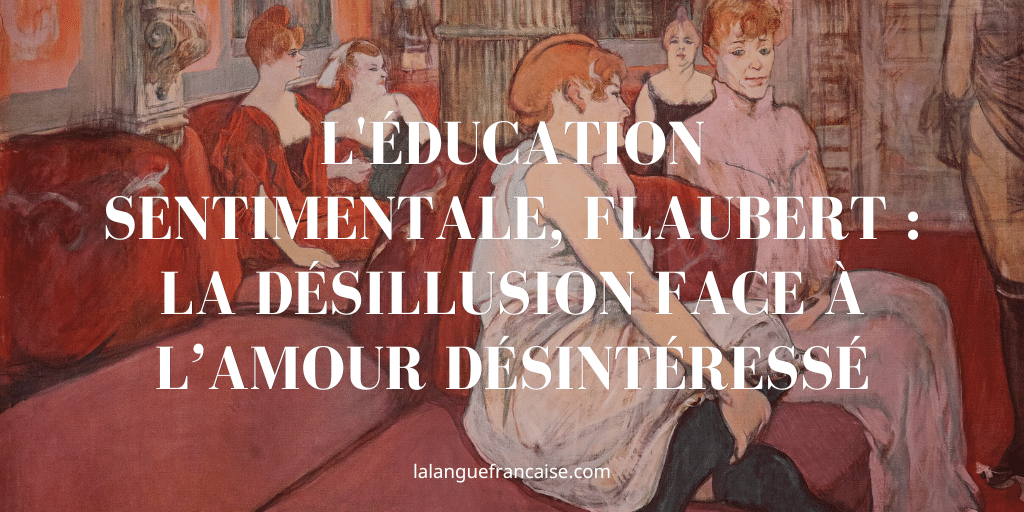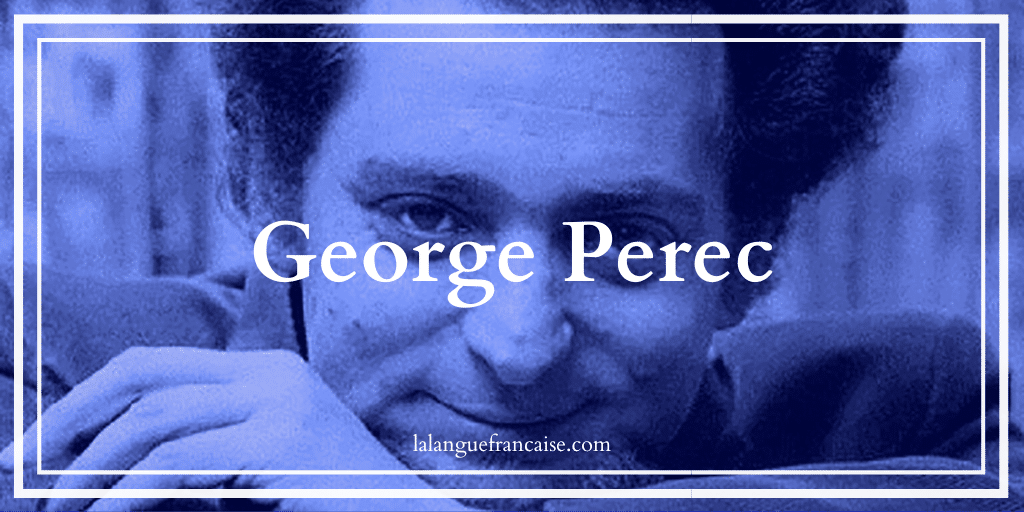André Gide (1869-1951) : vie et œuvre

Débutée sous les enseignes du symbolisme, l’œuvre littéraire de Gide se poursuit jusqu’au milieu du XXe siècle, lors de l’avènement de la littérature engagée.
Écrivain appliqué à l’examen du soi, passant de névrosé coupable à narcissique lucide, toujours à la recherche d’un discours sur l’homme pour nourrir son œuvre, André Gide est surtout l’incarnation de la contradiction : entre un attrait pour les plaisirs mais un penchant pour le puritanisme, sincère jusqu’au dénuement mais retors… « Les extrêmes me touchent », dira-t-il.
De grand inquiété à inquiéteur, André Gide construit sa vie et sa littérature sur le rapport que l’homme entretient avec ses certitudes. L’écrivain se fait ainsi un devoir de remuer tout ce que l’homme et la société entretiennent de stagnant en eux afin d’éviter une sorte d’engourdissement moral.
Il est en quelque sorte le fils spirituel de Goethe et de Montaigne, par sa propension à se passionner pour la vie dans toutes ses manifestations (« J’étais grisé par la diversité de la vie, qui commençait à m’apparaître, et par ma propre diversité », écrit-il dans Si le grain ne meurt, en 1926), mais aussi de Rousseau par la pratique de l’écriture du moi.
En marge de son œuvre romanesque, Gide s’est aussi fait connaître par sa plume critique qui a permis de populariser en France la lecture d’auteurs étrangers (qu’ils soient Anglais, Russes ou Allemands), sans compter son rôle en ce qui concerne l’établissement de « l’esprit NRF » (la Nouvelle Revue française), pour laquelle il est chargé de trouver de nouveaux talents.
Enfin, Gide a joué un rôle dans le développement de la littérature française, notamment avec son roman le plus célèbre, Les Faux-Monnayeurs, en cela qu’il a tenté de renouveler le genre par un mode de narration nouveau et une composition en abyme.
Qui est André Gide ?
André Gide est né à Paris, le 22 novembre 1869. De son père professeur de droit et de sa mère issue de la haute bourgeoisie havraise, il reçoit une éducation protestante stricte. Choyé par ses parents, il est cependant tourmenté par ses camarades de classe et souffre d’angoisses.
Son père meurt alors qu’il a dix ans, mais sa mère surveille de près son éducation et il se découvre un grand intérêt pour la littérature. Il passe ses vacances en Normandie, à Uzès, chez sa grand-mère maternelle où il voit régulièrement ses cousines, dont Madeleine Rondeaux, dont il tombe amoureux à l’âge de quinze ans, mais d’un amour platonique qu’il distingue de l’attraction physique. En effet, lui qui s’est fait renvoyer de l’École Alsacienne durant trois mois en 1877 pour « mauvaises habitudes » (c’est-à-dire la masturbation), voue pour sa cousine un amour mystique et pur, aux airs d’exaltation héroïque.
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Sa fortune familiale l’exempt très tôt du tracas de se trouver un travail, ce qui lui permet de s’abandonner à l’écriture, exercice auquel il a pris goût et qu’il développe entouré de ses amis Pierre Louÿs et Paul Valéry, ainsi que chapeauté par Stéphane Mallarmé. C’est ainsi qu’il fait ses premiers pas dans le symbolisme.
Dès l’âge de vingt-deux ans, il livre ses premiers écrits, qui deviendront ses œuvres de jeunesse. Il s’y confond avec le héros de ses aventures, baptisé André Walter, qu’il fait vivre au travers de plusieurs publications : Les Cahiers d’André Walter (1891), Les Poésies d’André Walter (1892), Le Traité du Narcisse (1891) et Le Voyage d’Urien (1893).
A l’âge de vingt-quatre ans, sa vie prend un tournant décisif. Il s’embarque pour la Tunisie en octobre 1893 avec son ami le peintre P.-A. Laurens. Il y tombe malade et en revient, deux ans plus tard pris d’une soudaine voracité de vivre, délivré de ses tourments moraux, mais toujours attaché à la dualité qui affleurait déjà dans son adolescence : d’une part, cet élan chaste et plein de maintien qui le lie à Madeleine, sa « soeur », qu’il considère déjà comme sa fiancée, d’autre part l’aveu de son homosexualité et le besoin d’assouvir tous ses désirs (on peut retrouver l’écho de cet épisode de la vie de Gide dans son ouvrage L’Immoraliste, publié plus tard en 1902).
C’est en équilibre entre cette soif de spirituel et cette exigence du charnel qu’André Gide va poursuivre sa vie. Peu après la mort de sa mère, il épouse sa cousine Madeleine, le 8 octobre 1895, qui accepte le mariage blanc. De retour dans les cercles littéraires, il critique amèrement une littérature contemporaine fade et hypocrite (Paludes, 1895). Le narrateur de Paludes affirme ainsi : « Ce qu’il faut indiquer, c’est que chacun, quoique enfermé, se croit dehors. Misère de ma vie ! » .
Alors que sa littérature n’est réservée et appréciée pour le moment que d’un cercle restreint, il publie Les Nourritures terrestres en 1897. Tout comme dans L’Immoraliste, ce récit est celui d’une forme de conversion, de la renaissance qu’il a vécue, qui a fait de lui un « nouvel être ».
En 1909, il publie La Porte étroite, un des premiers ouvrages de l’écrivain qui attire la critique et lui confère une certaine renommée. Il prend peu de temps après une part active dans la NRF (Nouvelle Revue française, fondée en 1908) et est chargé de dénicher de nouvelles plumes et nouveaux talents.
L’influence de Gide ne cesse de s’accroître, mais il n’échappe pas à la critique et est accusé, comme le philosophe d’Alopèce avant lui, de corrompre la jeunesse, notamment par le biais de ses attaques contre la famille et le couple.
André Gide assoit sa notoriété avec Isabelle, publié en 1911, et avec la désinvolture et le ton à la fois burlesque et grave des Caves du Vatican (qu’il considère comme une « sotie »), publié en 1914, à la veille du premier conflit mondial durant lequel l’écrivain s’enferme dans le silence, rédigeant dans l’intimité son Journal (publié à partir de 1939).
Les critiques ne peuvent que saluer la perfection de la prose gidienne et la maîtrise de la composition qu’on trouve dans ses récits.
Le grand inquiéteur
Au cours de la Première Guerre mondiale, André Gide voit ressurgir ses inquiétudes religieuses sous forme de drame personnel : un certain nombre de ses amis se convertissent au catholicisme (Ghéon, Copeau, Rivière), il se croit un temps attiré lui aussi par cette voie, dont ses camarades de lettres Jammes et Claudel se sont fait depuis quelques temps les porte-étendards.
Alors que l’écrivain a passé une partie de la guerre à se dévouer à un foyer franco-belge d’aide aux réfugiés, il se plonge avec assiduité dans la relecture des Evangiles. Il les annote et les médite. De cette crise mystique naît Numquid et tu (1922). C’est une première libération pour Gide qui semble trouver, même au coeur des Écritures saintes, une « loi de l’amour » qui légitime ses aspirations.
Peu de temps après survient une crise conjugale : sa femme a appris, par le biais d’une lettre ambigüe, les relations homosexuelles de Gide (mais aussi pédérastes, voire pédophiles – Julien Green, dans son journal, parle du tourisme sexuel de Gide en Tunisie). Elle déchire leurs échanges de jeunesse, dans lesquels Gide livrait le « meilleur de lui-même ». L’écrivain vit cette déchirure comme une forme d’affranchissement : il peut enfin cesser de se voiler la face, non seulement dans sa vie, mais aussi dans son œuvre.
En 1919, il publie La Symphonie pastorale, qui lui permet de se libérer de « sa dernière dette envers le passé » (le roman traite d’un thème commun à Gide, le conflit entre la morale religieuse et les sentiments).
Il publie ensuite Si le grain ne meurt en 1920, puis Corydon, en 1924, ouvrage dans lequel il rend public ses penchants pédérastes au travers de quatre « dialogues socratiques ». Ces œuvres, exhalant de scandale mais aussi de génie littéraire, projettent à nouveau Gide sur le devant de la scène au moment-même où la littérature est de plus en plus engagée. Devant lui se dressent aussi de nombreuses résistances et d’anciens adversaires (Henri Massis, Henri Béraud), et il se voit qualifier de « malfaiteur ».
À propos de ceux qui poussent des cris d’orfraie, Gide commente dans son Journal, à la date du 28 mars 1935 : « Belle fonction à assurer, celle d’inquiéteur ». La fonction littéraire de Gide n’est plus seulement destinée à soulever des interrogations ou pousser dans leur retranchement les parangons de morale, mais tente de prendre un tournant social, sans jamais se départir cependant d’une certaine contradiction dans ses engagements.
Il part pour un long voyage au Congo, fustige le colonialisme, tel un missionnaire social (il publie le Voyage au Congo en 1927), abandonne un temps son positionnement narcissique pour faire dans l’altruisme positif en se rendant au Congrès mondial pour la paix en 1932, mais aussi en soutenant le communisme militant et en se rendant en Russie en 1936 (il en revient néanmoins désenchanté par le formalisme stalinien).
Entretemps, il a publié ce qu’il considère comme son seul et véritable roman, Les Faux-Monnayeurs, en 1925, par lequel il révolutionne la conception traditionnelle du roman.
En 1938, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, sa femme meurt. Il livre au public cinquante ans de sa conscience en publiant, l’année suivante, son Journal (1889-1939).
La fin de la vie de Gide est marquée par l’éloignement, puis l’exil forcé par l’occupation allemande. Il retourne en Tunisie et y termine Thésée, qu’il fait paraître en 1946. Ce récit écrit à la première personne, que Gide mit vingt ans à écrire, livre des réflexions générales aux accents philosophiques sur la vie : « Les hommes, lorsqu’ils s’adressent aux dieux, ne savent pas que c’est pour leur malheur, le plus souvent, que les dieux les exaucent », c’est le dernier ouvrage publié du vivant de l’auteur.
Honoré du prix Nobel de littérature en 1947, Gide meurt en 1951, laissant derrière lui une dernière confession, Et nunc manet in te, dans lequel il revient sur la relation torturée qu’il entretenait avec sa femme, et de quels sacrifices, de quelles angoisses morales, s’est accompagnée sa volonté de vivre libre.
L’oeuvre d’André Gide
Le « gidisme » se définit par une oeuvre variée qui compte plus de soixante titres. L’unité de ce travail tient dans la perpétuelle présence de son auteur qui a fait de ses tergiversations morales, théologiques et philosophiques la matière principale de sa littérature.
Gide a pratiqué l’aveu, constamment et sous toutes ses formes (confession lyrique, journal, récit autobiographique, etc.) Car, à la différence d’un Stendhal pour lequel ses personnages étaient une opportunité de prendre sa revanche sur une vie qui ne lui apportait pas une pleine satisfaction, Gide ne cherche pas à échapper aux inclinations qui sous-tendent sa vie entière et les placent au cœur de ses récits.
Gide, qui, comme le rêveur solitaire, a pratiqué l’écriture du moi, est aussi resté présent dans les mémoires comme l’écrivain de l’affirmation de soi jusqu’au défi, jusqu’à mettre à mal ses propres croyances, religieuses et sociales.
C’est ainsi qu’apparaissent de nombreux paradoxes chez Gide, qui sont ses propres dilemmes cornéliens, avec lesquels il ne peut s’empêcher de jouer : « Suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant », affirme-t-il.
À cet effort de sincérité totale, Gide a ajouté une application particulière à l’écriture et à la composition romanesque. C’est par la grâce de sa prose, le refus des ornements et du superflu, l’abandon de ses trop grands penchants symbolistes, l’usage d’un vocabulaire étudié, la confection d’une syntaxe en rupture, la somme d’érudition que contiennent ses publications, que Gide a pu aussi se faire une place dans le Panthéon de la littérature française et qu’il est aujourd’hui considéré comme un « classique ».
Dans Les Nourritures terrestres, que l’on peut considérer comme la première grande œuvre de Gide (publiée en 1897), on découvre le point de départ lyrique du gidisme : l’écrivain inquiet y est prêt, déjà, à se confier sur l’épiphanie qu’a été pour lui son premier séjour en Tunisie. On y lit la véhémence de Gide pour la vie, dont il semble seulement découvrir la densité : « Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur… Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité… Il faut Nathanaël que tu brûles en toi tous les livres… Jusqu’où mon désir peut s’étendre, là j’irai… nathanaël, je ne crois plus au péché… Nathanaël, je t’enseignerai que toutes choses sont divinement naturelles… Nathanaël, ne distingue pas Dieu de ton bonheur. »
L’appétit jamais assouvi tant spirituel que charnel, l’exhibition de désirs stigmatisants (voire interdits) et la ferveur mise dans la recherche du soi, de ce qui définit le rapport à l’autre, réflexion poussée jusqu’aux limites de l’acceptable, sont des thèmes présents et travaillés dans chacune des grandes œuvre de Gide. Ainsi, le renoncement de Jérôme dans La Porte étroite, ainsi l’acte gratuit de Lafcadio, personnage des Caves du Vatican, ainsi les intrications des Faux-Monnayeurs…
Les Faux-Monnayeurs, considéré comme le seul véritable roman de Gide, à en croire ses propres mots, constitue le sommet de l’art gidien. Par cette œuvre dans laquelle la narration est mise en abyme et les voix ne cessent de s’entremêler, Gide a voulu toucher à l’essence pure du roman. « J’ai eu soin de n’indiquer que le significatif, le décisif, l’indispensable », commente-t-il.
En effet, l’écrivain a pris soin de gommer au maximum les traits physiques, les paysages trop, permettant une forme d’ambiguïté entre la réalité des événements et la réalité des sentiments. Ce « roman d’un roman » (formule utilisée par le romancier Édouard dans le livre) livre enfin une réflexion nécessaire pour l’époque (puisqu’elle annonce le nouveau roman) sur la composition romanesque : là où le roman revêt un intérêt, ce n’est pas dans le récit qu’il livre (puisque dans sa volonté de s’imposer comme vérité, il échoue toujours), mais dans les techniques et les procédés mis en oeuvre pour atteindre ce but. Comme l’affirme Gide lui-même : « C’est là le sujet principal, le centre nouveau qui désaxe le récit et l’entraîne vers l’imaginatif ».