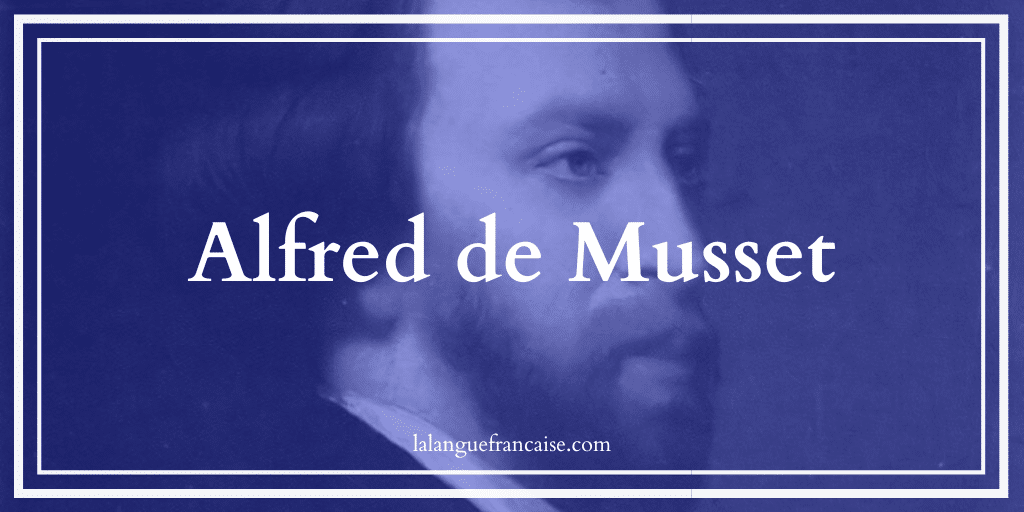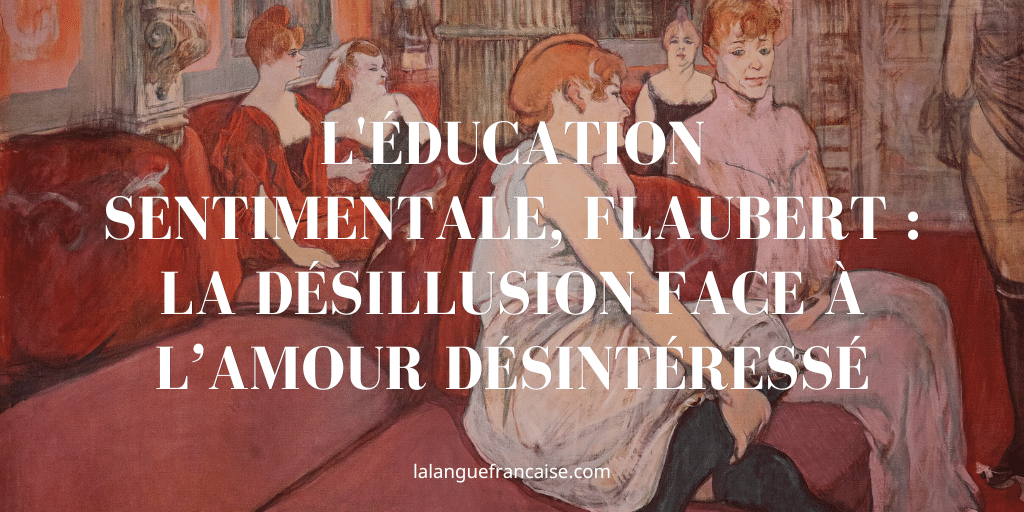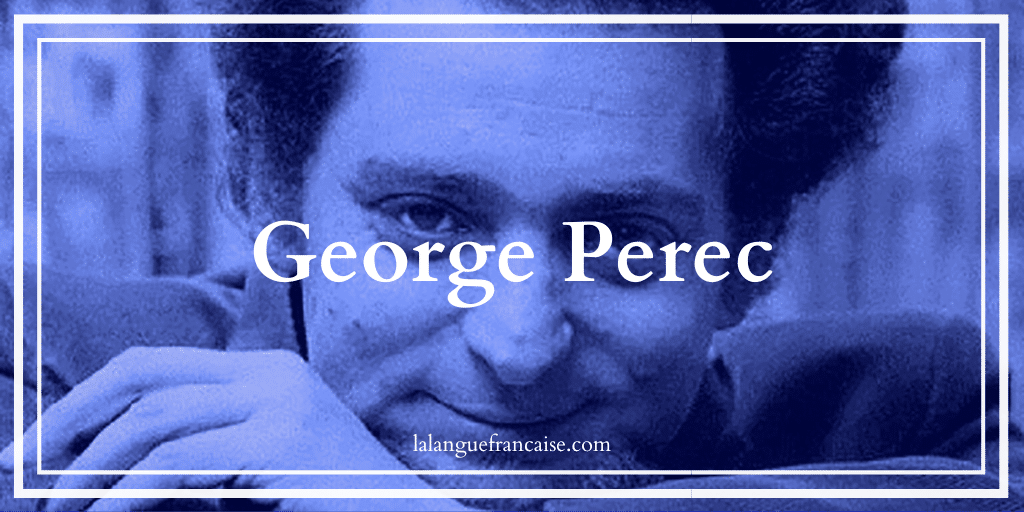Le nouveau roman (1950 - 1990) : mouvement littéraire
« Le roman n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture », écrit l’écrivain Ricardou en 1963, dans Pour une théorie du Nouveau Roman. A l’époque où il fait cette affirmation, le Nouveau Roman n’en est qu’à ses prémices : il n’est pas encore un mouvement à proprement parler, à peine une mouvance, un sursaut de la part de quelques écrivains désireux de réinventer l’approche romanesque.
C’est autour des éditions de Minuit, dirigées par Jérôme Lindon, que gravitent ces écrivains nouveaux que sont Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon ou encore Michel Butor. Leur but ? Faire un roman expérimental, mais aussi un roman du regard et du détail, redéfinir le personnage, s’attacher à son « flux de conscience » et adopter un point de vue structuraliste en ce qui concerne la place du lecteur et du narrateur.
D’abord mal reçus par la critique car les textes sont considérés comme illisibles, abscons ou sans véritable fond (les personnages sont souvent anonymes, l’intrigue est énigmatique, le narrateur indécis, etc.), certains auteurs recevront par la suite tous les honneurs : Claude Simon est récompensé par le Prix Nobel de la littérature en 1985 et Nathalie Sarraute entrera de son vivant dans la Pléiade.
Origines du Nouveau Roman
Avant même que les éditions de Minuit ne regroupe les auteurs qui formeront plus tard l’école du Nouveau Roman, c’est à un journaliste du Monde, Emile Henriot, que l’on doit cette terminologie. Il l’emploie dans un article du 22 mai 1957 pour parler de Tropismes de Nathalie Sarraute et La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet qui viennent tout juste de paraître.
Les années 1950 touchent à leur fin, et le Nouveau Roman n’est pas encore reconnu comme un mouvement littéraire à proprement parler. Car ceux que l’on associe – parfois malgré eux – à ce courant ne s’en réclament pas et forment tout juste un groupe d’écrivains publiés pour la plupart aux éditions de Minuit et doté d’une nouvelle conception de la littérature. En effet, le mouvement du Nouveau roman n’est pas né d’une concertation d’auteurs, ni d’un cercle littéraire et encore moins d’un Manifeste.
Ce que l’on appelle aujourd’hui le Nouveau Roman a émergé spontanément, d’une certaine façon, dans la mesure où quelques écrivains de l’après-guerre ont tiré la même conclusion : le roman balzacien et ses règles sont caduques. Ce mouvement est avant tout un produit de son temps, c’est-à-dire d’une époque qui voit s’imposer la massification dans tous les domaines (notamment dans le domaine de la culture) et doute de sa définition de la nature humaine.
Si la terminologie de « nouveau roman » ne s’impose qu’au milieu des années 1950, cette nouvelle vision du roman existe, elle, depuis quelques années déjà. Elle a été inspirée d’une part par certains écrivains étrangers, comme Kafka ou Virginia Woolf, mais aussi par L’Etranger d’Albert Camus (livre publié en 1942) ou encore par La Nausée de Jean-Paul Sartre (publié en 1938).
Sur le plan des idées, la conception de cette nouvelle écriture s’appuie sur deux courants de pensée. Le premier, philosophique, est l’existentialisme, le second, plus large, est le structuralisme (théorie émanant du positivisme et développée par Barthes en littérature, Claude Lévi-Strauss en anthropologie ou Michel Foucault en philosophie).
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Les nouveaux romanciers
Le Nouveau Roman n’était, à ses balbutiements, qu’une « mouvance ». Comme nous l’avons souligné, les écrivains que l’on a par la suite rassemblés sous cet étendard littéraire n’ont répondu à l’appel d’aucun chef de file, d’aucune revue, d’aucune doctrine précise. A ses débuts, le Nouveau Roman est un phénomène éditorial et critique.
D’une part, de jeunes écrivains émergent dans le paysage littéraire, rassemblés par Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit. Ce dernier, en quête de nouveauté, s’est donné comme but de créer une « école de Minuit ». On y retrouve, au fil des ans, des écrivains tels que Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon ou Michel Butor. D’autre part, la presse alimente cette nouvelle vague littéraire tout en la critiquant.
C’est au cours des années 1960 qu’un mouvement se consolide véritablement. Alain Robbe-Grillet rédige le recueil critique Pour un nouveau roman, qui paraît en 1963. Le romancier Jean Ricardou devient lui aussi un théoricien du mouvement et publie Problèmes du nouveau roman en 1967. Dans ces deux ouvrages sont abordés les questions de temporalités (le temps de narration et le temps de fiction), ainsi que la question de la mise en abyme.
Durant les deux décennies 1950 et 1960, les œuvres affiliées au Nouveau Roman se multiplient et se voient saluées par la critique : Le Voyeur, de Robbe-Grillet, reçoit le prix des Critiques en 1955 ; La Modification, de Butor, le Renaudot en 1957 ; La Mise en scène, d’Ollier, le Médicis en 1958 ; La Route des Flandres, de Simon, le prix de l’Express en 1960.
Les règles du Nouveau Roman
Le Nouveau Roman est avant tout une remise en question des formes narratives du roman et de ce qui le constitue, c’est-à-dire un ou plusieurs personnages autour d’une intrigue et au cœur d’un récit. Comme le dit Alain Robbe-Grillet dans Pour un nouveau roman, en 1963 : « L’écriture, comme toute forme d’art, est une intervention ».
- Le rejet des règles classiques du roman : notamment la mort du héros balzacien et la naissance d’un personnage anonyme et énigmatique.
- L’exploration des flux de conscience et la priorité donnée à la vie psychologique des personnages.
- Disparition de l’auteur au profit d’un texte ouvert.
- Participation active du lecteur qui est élevé au rang de créateur.
« Le roman est l’expression d’une société qui change ; il devient bientôt celui d’une société qui a conscience de changer », écrit Michel Butor en 1968 dans Répertoire III. A l’image de la conception qu’on se fait de l’homme à l’époque, après le passage de Freud en psychologie et du surréalisme en poésie, le personnage du Nouveau Roman est souvent anonyme, parfois réduit à une simple initiale et donne la part belle à ses divagations intérieures en constante mutation.
De fait, la première dénonciation des écrivains affiliés au Nouveau Roman est celle du héros traditionnel balzacien, qui selon eux renvoie à une vision surannée de la nature humaine ; à la peinture diégétique d’un caractère ancré dans un univers ultra précis (nom, personnalité, univers social et familial, type), ils préfèrent l’exploration des flux de conscience.
En outre, le Nouveau Roman est une fiction de l’intime. Mais loin du roman épistolaire par exemple, au cours duquel le sujet livre ses confessions, le Nouveau Roman tente de saisir quels sont les chemins empruntés par la conscience pour s’approprier le réel. Ici, c’est davantage chez Zola ou Flaubert que les écrivains de cette seconde moitié du XXe puisent leur inspiration, notamment dans l’utilisation d’un discours indirect libre auquel s’ajoute une trame souvent énigmatique. Nathalie Sarraute en fait le sujet de son roman Tropismes, dans lequel elle explore ce qu’on peut aussi appeler les « sous-conversations » :
[…] [ces] mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de la conscience ; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu’il est possible de définir. Ils me paraissaient et me paraissent encore définir la source secrète de notre existence. […] A ces mouvements qui existent chez tout le monde et peuvent à tout moment se déployer chez n’importe qui, des personnages anonymes, à peine visibles, devaient servir de simple support.
Nathalie Sarraute, Le Langage dans l’art du roman
Autre caractéristique essentielle du Nouveau Roman : la place accordée au lecteur, qui doit être actif, qui doit « remplir les trous » laissés par le narrateur. En effet, le Nouveau Roman repense la relation entre le destinataire et le destinateur. Le narrateur ne tranche jamais en faveur d’un personnage ou d’un autre, le récit est toujours ouvert à l’interprétation du lecteur. Dans Le Langage dans l’art du roman, Nathalie Sarraute poursuit, parlant toujours des « sous-conversations », ces mouvements imperceptibles de la conscience :
Rien ne devait en distraire le lecteur : ni caractères de personnages, ni intrigue romanesque à la faveur de laquelle, d’ordinaire, ces personnages se développent, ni sentiments connus et nommés.
Nathalie Sarraute, Le Langage dans l’art du roman
C’est pourquoi le roman se présente comme une démonstration, essaimée de doutes, d’hypothèses, dépouillé de tout déterminant qui pourrait influencer la conscience du lecteur. Le narrateur est constamment spectateur, il rapporte ce qu’il entend et ce qu’il voit sans pour autant donner une orientation aux actions et paroles dont il est le témoin. L’écriture du roman est alors une expérimentation.
Ainsi, pour Michel Butor (ainsi que pour ses confrères du Nouveau Roman), le roman est « le laboratoire du récit », « le domaine phénoménologique par excellence, le lieu par excellence où étudier de quelle façon la réalité nous apparaît ou peut nous apparaître » (Michel Butor, « Le roman comme recherche », in Essais sur le roman, 2003)
Extraits d’auteurs du Nouveau Roman
Par les journées de juillet très chaudes, le mur d’en face jetait sur la petite cour humide une lumière éclatante et dure.
Il y avait un grand vide sous cette chaleur, un silence, tout semblait en suspens ; on entendait seulement, agressif, strident, le grincement d’une chaise traînée sur le carreau, le claquement d’une porte. C’était dans cette chaleur, dans ce silence – un froid soudain, un déchirement.
Et elle restait sans bouger sur le bord de son lit, occupant le plus petit espace possible, tendue, comme attendant que quelque chose éclate, s’abatte sur elle dans ce silence menaçant.
Quelquefois le cri aigu des cigales, dans la prairie pétrifiée sous le soleil et comme morte, provoque cette sensation de froid, de solitude, d’abandon dans un univers hostile où quelque chose d’angoissant se prépare.
Étendu dans l’herbe sous le soleil torride, on reste sans bouger, on épie, on attend.
Elle entendait dans le silence, pénétrant jusqu’à elle le long des vieux papiers à raies bleues du couloir, le long des peintures sales, le petit bruit que faisait la clef dans la serrure de la porte d’entrée. Elle entendait se fermer la porte du bureau.
Elle restait là, toujours recroquevillée, attendant, sans rien faire. La moindre action, comme d’aller dans la salle de bains se laver les mains, faire couler l’eau du robinet, paraissait une provocation, un saut brusque dans le vide, un acte plein d’audace. Ce bruit soudain de l’eau dans ce silence suspendu, ce serait comme un signal, comme un appel vers eux, ce serait comme un contact horrible, comme de toucher avec la pointe d’une baguette une méduse et puis d’attendre avec dégoût qu’elle tressaille tout à coup, se soulève et se replie.
Elle les sentait ainsi, étalés, immobiles, derrière les murs, et prêts à tressaillir, à remuer.
Elle ne bougeait pas. Et autour d’elle toute la maison, la rue semblaient l’encourager, semblaient considérer cette immobilité comme naturelle.
Il paraissait certain, quand on ouvrait la porte et qu’on voyait l’escalier, plein d’un calme implacable, impersonnel et sans couleur, un escalier qui ne semblait pas avoir gardé la moindre trace des gens qui l’avaient parcouru, pas le moindre souvenir de leur passage, quand on se mettait derrière la fenêtre de la salle à manger et qu’on regardait les façades des maisons, les boutiques, les vieilles femmes et les petits enfants qui marchaient dans la rue, il paraissait certain qu’il fallait le plus longtemps possible – attendre, demeurer ainsi immobile, ne rien faire, ne pas bouger, que la suprême compréhension, que la véritable intelligence, c’était cela, ne rien entreprendre, remuer le moins possible, ne rien faire.
Tout au plus pouvait-on, en prenant soin de n’éveiller personne, descendre sans le regarder l’escalier sombre et mort, et avancer modestement le long des trottoirs, le long des murs, juste pour respirer un peu, pour se donner un peu de mouvement, sans savoir où l’on va, sans désirer aller nulle part, et puis revenir chez soi, s’asseoir au bord du lit et de nouveau attendre, replié, immobile.
Nathalie Sarraute, Tropismes
Fort de ses trois ans d’expérience, Franck pense qu’il existe des conducteurs sérieux, même parmi les noirs. A… est aussi de cet avis, bien entendu.
Elle s’est abstenue de parler pendant la discussion sur la résistance comparée des machines, mais la question des chauffeurs motive de sa part une intervention assez longue et catégorique.
Il se peut d’ailleurs qu’elle ait raison. Dans ce cas, Franck devrait avoir raison aussi.
Tous les deux parlent maintenant du roman que A… est en train de lire, dont l’action se déroule en Afrique. L’héroïne ne supporte pas le climat tropical (comme Christiane). La chaleur semble même produire chez elle de véritables crises :
“C’est mental, surtout, ces choses-là”, dit Franck.
Il fait ensuite une allusion, peu claire pour celui qui n’a pas feuilleté le livre, à la conduite du mari. Sa phrase se termine par “savoir la prendre” ou “savoir l’apprendre”, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude de qui il s’agit, ou de quoi. Franck regarde A…, qui regarde Franck. Elle lui adresse un sourire rapide, vite absorbé par la pénombre. Elle a compris, puisqu’elle connaît l’histoire.
Non, ses traits n’ont pas bougé. Leur immobilité n’est pas si récente : les lèvres sont restées figées depuis ses dernières paroles. Le sourire fugitif ne devait être qu’un reflet de la lampe, ou l’ombre d’un papillon.
Du reste, elle n’était déjà plus tournée vers Franck, à ce moment-là. Elle venait de ramener la tête dans l’axe de la table et regardait droit devant soi, en direction du mur nu, où une tache noirâtre marque l’emplacement du mille-pattes écrasé la semaine dernière, au début du mois, le mois précédent peut-être, ou plus tard.
Le visage de Franck, presque à contre-jour, ne livre pas la moindre expression.
Le boy fait son entrée pour ôter les assiettes. A… lui demande, comme d’habitude, de servir le café sur la terrasse.
Là, l’obscurité est totale. Personne ne parle plus. Le bruit des criquets a cessé.
Alain Robbe-Grillet, La Jalousie
Mardi prochain, lorsque vous trouverez Henriette en train de coudre à vous attendre, vous lui direz avant même qu’elle vous ait demandé quoi que ce soit : “Je t’ai menti, comme tu t’en es bien doutée ; ce n’est pas pour la maison Scabelli que je suis allé à Rome cette fois-ci, et c’est en effet pour cette raison que j’ai pris le train de huit heures dix et non l’autre, le plus rapide, le plus commode, qui n’a pas de troisième classe ; c’est uniquement pour Cécile que je suis allé à Rome cette fois-ci, pour lui prouver que je l’ai choisie définitivement contre toi, pour lui annoncer que j’ai enfin réussi à lui trouver une place à Paris, pour lui demander de venir afin qu’elle soit toujours avec moi, afin qu’elle me donne cette vie extraordinaire que tu n’as pas été capable de m’apporter et que moi non plus je n’ai pas su t’offrir ; je le reconnais, je suis coupable à ton égard, c’est entendu, je suis prêt à accepter, à approuver tous tes reproches, à me charger de toutes les fautes que tu voudras si cela peut t’aider le moins du monde à te consoler, à atténuer le choc, mais il est trop tard maintenant, les jeux sont faits, je n’y puis rien changer, ce voyage a eu lieu, Cécile va venir • tu sais bien que je ne suis pas une si grande perte, ce n’est pas la peine de fondre en larmes ainsi…”
Mais vous savez bien qu’elle ne pleurera nullement, qu’elle se contentera de vous regarder sans proférer une parole, qu’elle vous laissera discourir sans vous interrompre, que c’est vous, tout seul, par lassitude, qui vous arrêterez, et qu’à ce moment-là vous vous apercevrez que vous êtes dans votre chambre, qu’elle est déjà couchée, qu’elle est en train de coudre, qu’il est tard, que vous êtes fatigué de ce voyage, qu’il pleut sur la place.
Michel Butor, La Modification
Et Blum : « Et alors … » (mais cette fois Iglésia n’était plus là : tout l’été ils le passèrent une pioche (ou, quand ils avaient de la chance, une pelle) en main à des travaux de terrassement puis au début de l’automne ils furent envoyés dans une ferme arracher les pommes de terre et les betteraves, puis Georges essaya de s’évader, fut repris (par hasard, et non par des soldats ou des gendarmes envoyés à sa recherche mais – c’était un dimanche matin – dans un bois où il avait dormi, par de paisibles chasseurs), puis il fut ramené au camp et mis en cellule, puis Blum se fit porter malade et rentra lui aussi au camp, et ils y restèrent tous les deux, travaillant pendant les mois d’hiver à décharger des wagons de charbon, maniant les larges fourches, se relevant lorsque la sentinelle s’éloignait, minables et grotesques silhouettes, avec leurs calots rabattus sur leurs oreilles, le col de leurs capotes relevé, tournant le dos au vent de pluie ou de neige et soufflant dans leurs doigts tandis qu’ils essayaient de se transporter par procuration c’est-à-dire au moyen de leur imagination, c’est-à-dire en rassemblant et combinant tout ce qu’ils pouvaient trouver dans leur mémoire en fait de connaissances vues, entendues ou lues, de façon-là, au milieu des rails mouillés et luisants, des wagons noirs, des pins détrempés et noirs, dans la froide et blafarde journée d’un hiver saxon – à faire surgir les images chatoyantes et lumineuses au moyen de l’éphémère, l’incantatoire magie du langage, des mots inventés dans l’espoir de rendre comestible – comme ces pâtes vaguement sucrées sous lesquelles on dissimule aux enfants les médicaments amers – l’innommable réalité dans cet univers futile, mystérieux et violent dans lequel, à défaut de leur corps, se mouvaient leur esprit: quelque chose peut-être sans plus de réalité qu’un songe, que les paroles sorties de leurs lèvres: des sons, du bruit pour conjurer le froid, les rails, le ciel livide, les sombres pins.
Claude Simon, La Route des Flandres