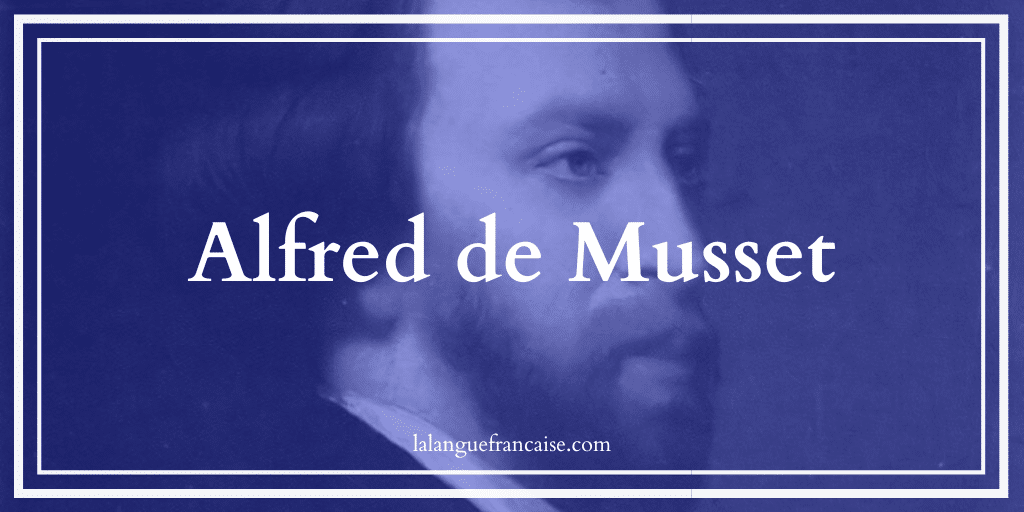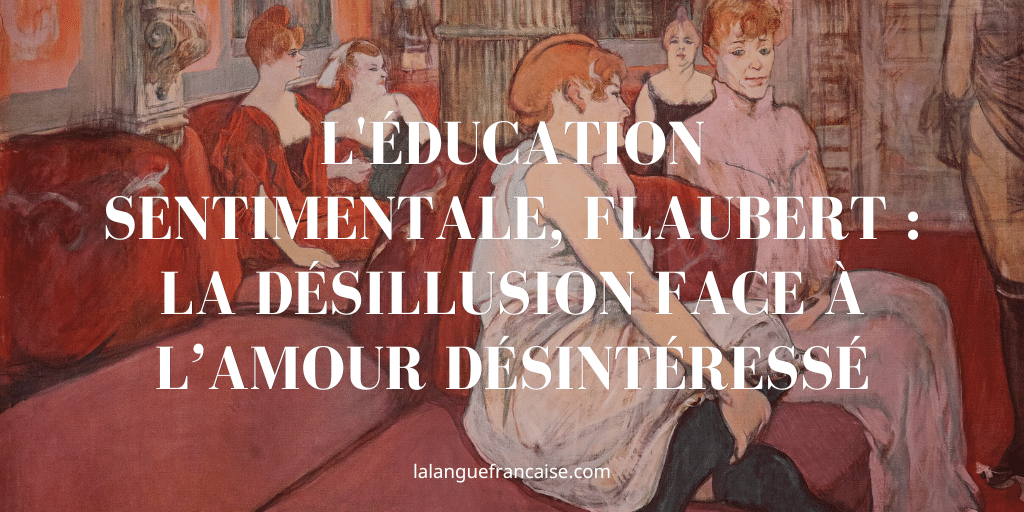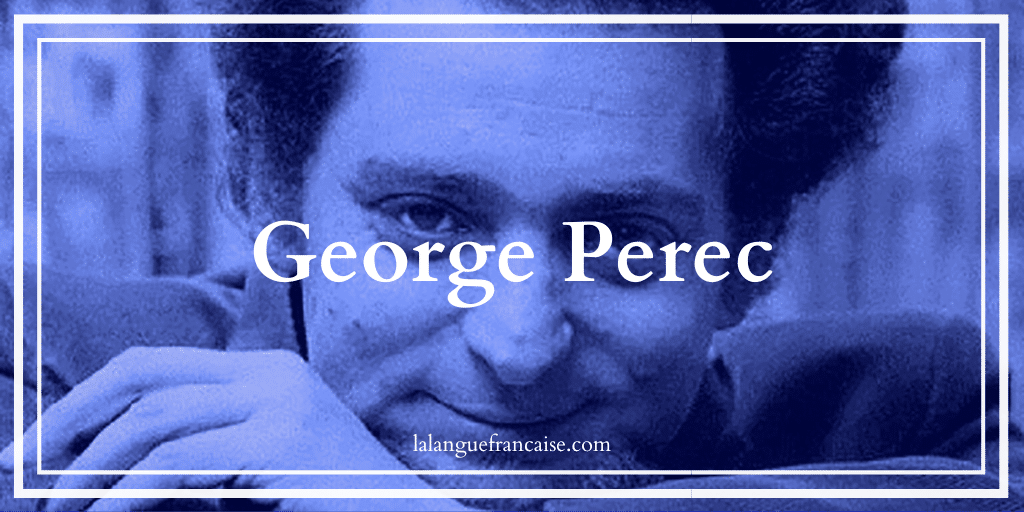Le réalisme (XIXe siècle)
« Ah ! la vie, la vie ! la sentir et la rendre dans sa réalité […] faire vivre et faire des hommes, la seule façon d’être Dieu ! », s’écrie le romancier Sandoz, personnage de l’Œuvre, d’Émile Zola qui appartient davantage au naturalisme, né du réalisme à la fin du XIXe siècle.
Mais ce mouvement, porté par l’auteur des Rougon-Macquart, a parachevé ce que le réalisme avait initié, et exprime ici en somme la principale idée sur laquelle s’est fondé le réalisme : la nécessité de se réclamer de la vérité dans la création romanesque et de consacrer le roman comme peinture authentique de la société.
En outre, on ne peut pas s’étonner que ce siècle, au cours duquel la France a connu sept régimes politiques (le Consulat, l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République), ait aussi vu tant de courants d’idées et de mouvements littéraires s’enchevêtrer et se nourrir les uns des autres. Car né du romantisme, le réalisme ne tarde pas à se révolter contre lui.
C’est pourquoi, au sortir d’une nouvelle crise politique et à l’aube de la Révolution industrielle, un mouvement d’hélice en chasse un autre : les écrivains, las de la promesse non tenue par le romantisme, se tournent vers une nouvelle vision de l’art, enracinée dans les choses de la vie.
Rappelons en effet l’étymologie du mot réalisme, qui vient du latin realis, c’est-à-dire ce qui est relatif aux choses matérielles, mot lui-même dérivé de res, l’objet, la chose matérielle, le corps, la créature, et enfin, la réalité.
Origines du réalisme
Contexte historique
Au moment où le réalisme naît, la Révolution de 1848 a renversé la monarchie constitutionnelle de Louis Philippe et instaure la Seconde république. Un coup d’État, en 1851, mené par Louis Napoléon Bonaparte, établit un régime autoritaire, mais de plus en plus libéral à mesure que l’on se rapproche des années 1860.
Après la défaite des troupes françaises face à la Prusse, la Troisième République est proclamée. C’est l’avènement de la démocratie parlementaire qui a pour but de garantir les libertés fondamentales. Héritant de ces grands troubles politiques, les gens de lettres, les penseurs, les artistes, se détachent de la vision romantique et idéalisée de la réalité.
En effet, la vision jusqu’ici prônée par le romantisme, pétrie de mystères, de fantastique, qui laisse une grande part à l’imagination, s’accorde mal avec le climat de l’époque. Les réalistes fustigent cette déformation du réel que l’on met au service de l’esthétique ou de l’expression de soi. Fini les complaintes sentimentales, place à l’étude des faits, des comportements, des classes sociales.
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
En second lieu, la Révolution industrielle pousse ses machines dans la seconde moitié du siècle et bouleverse le quotidien de la majorité des Français. On voit l’essor de la machine à vapeur, des chemins de fer, de la marine. Ces progrès ont aussi pour effet de provoquer l’accroissement du prolétariat urbain et des mouvements ouvriers.
L’émergence de nouvelles classes sociales sont de nouvelles sources d’intérêt pour les artistes et écrivains. De leur côté, les sciences font aussi des progrès, notamment au niveau des sciences sociales, et les écrivains s’y intéressent de près en adoptant parfois une attitude aux prétentions scientifiques en ce qui concerne la composition romanesque.
Les manifestes du réalisme
Une des principales caractéristiques du réalisme est que le mouvement s’est essentiellement incarné dans la création romanesque. Le genre était jusqu’alors considéré comme inférieur, voire dangereux. Avec le réalisme, il va retrouver ses lettres de noblesse (notamment grâce à sa plus grande diffusion, les échos qu’il trouve dans les médias, les prix, etc.).
C’est bien des années avant la naissance officielle du réalisme, chez Denis Diderot, que l’on trouve les racines de ce mouvement littéraire. « Par un roman, on a entendu jusqu’à ce jour un tissu d’événements chimériques et frivoles, dont la lecture était dangereuse pour le goût et pour les mœurs », écrit l’écrivain des Lumières dans son Eloge de Richardson, en 1762. L’auteur de Jacques le Fataliste apporte déjà à l’époque une certaine légitimité au genre romanesque en lui conférant une valeur respectable, celle de la vérité, avant que les réalistes se revendiquent d’une peinture exacte de la société. Dans son Éloge à Richardson, il poursuit :
Ô Richardson ! j’oserai dire que l’histoire la plus vraie est pleine de mensonges, et que ton roman est plein de vérités. L’histoire peint quelques individus ; tu peins l’espèce humaine […] Sous ce point de vue, j’oserai dire que souvent l’histoire est un mauvais roman ; et que le roman, comme tu l’as fait, est une bonne histoire. Ô peintre de la nature ! c’est toi qui ne mens jamais.
Diderot, Éloge à Richardson
Au XIXe siècle, et surtout durant sa seconde partie, plusieurs auteurs, désireux de se débarrasser du sentimentalisme romantique, publient des œuvres qui se veulent proches d’une réalité crue, sans fioritures et dénuée de lyrisme (Victor Hugo en donne un aperçu avec Les Misérables, en 1862, et sa façon de rendre les conditions de vie des gens du peuple). Parmi les autres grands écrivains réalistes, on compte :
- Stendhal (1783-1842), avec Le Rouge et le Noir (1830) et La Chartreuse de Parme (1839)
- Honoré de Balzac (1799-1850), avec La Comédie humaine (1830) Le Père Goriot (1835) ou Les Illusions perdues (1837).
- Gustave Flaubert (1821-1880), avec Madame Bovary (1856) et L’Education sentimentale (1869)
- Guy de Maupassant (1850-1893), avec Boule de suif (1880) ; Une vie (1883) ou Bel-Ami (1885)
Honoré de Balzac, qui tire sa notoriété de son observation minutieuse du Paris bourgeois du XIXe, de ses codes et de ses mœurs, fait de l’avant-propos de la Comédie humaine un manifeste du réalisme : il y affirme vouloir décrire la société le plus fidèlement possible, en l’analysant avec précision et sans jamais se départir de la vérité. Il se veut historien des moeurs :
Ce n’était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque, car telle est, en définitif, la somme des types que présente chaque génération et que la Comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d’existences exigeaient des cadres et, qu’on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces 6 livres sont classées toutes les études de mœurs qui forment l’histoire générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d’ailleurs à des idées générales. Chacun d’eux a son sens, sa signification, et formule, une époque de la vie humaine.
Honoré de Balzac, avant-propos de la Comédie humaine
Guy de Maupassant fournit lui aussi une théorie du réalisme, dans son étude sur le roman (1888) qui devient la préface de son roman Pierre et Jean, publié la même année. Son ambition est de redéfinir les caractéristiques de la composition romanesque et de répondre à la question « qu’est-ce qu’un roman ? », qu’il formule ainsi : « Existe-t-il des règles pour faire un roman, en dehors desquelles une histoire écrite devrait porter un autre nom ? ». Il fait notamment la distinction entre « le romancier qui transforme la vérité constance, brutale, déplaisante, pour en tirer une aventure exceptionnelle et séduisante », dont le but est d’attendrir et d’émouvoir le lecteur, et le romancier qui « prétend donner une image exacte de la vie. » De ce dernier, qui nous intéresse, il dit :
Son but n’est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. À force d’avoir vu et médité il regarde l’univers, les choses, les faits et les hommes d’une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de l’ensemble de ses observations réfléchies. C’est cette vision personnelle du monde qu’il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre. Pour nous émouvoir, comme il l’a été lui-même par le spectacle de la vie, il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il devra donc composer son œuvre d’une manière si adroite, si dissimulée, et d’apparence si simple, qu’il soit impossible d’en apercevoir et d’en indiquer le plan, de découvrir ses intentions.
Mais c’est à Stendhal que l’on doit la plus célèbre définition du réalisme : le roman est un « miroir qui se promène sur une grande route ». Cette citation rappelle que l’objet de la création romanesque prôné par les réalistes est bien le réel et uniquement le réel. Cette affirmation permet surtout au roman de l’époque de se défendre des accusations d’immoralité.
Stendhal poursuit en ce sens son analyse du genre dans son roman Le Rouge et le Noir : « Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et les bourbiers se former ».
Gustave Flaubert, quant à lui, développe le principe selon lequel la peinture du monde extérieur ne peut se faire que si l’auteur s’efface et renonce à sa subjectivité pour atteindre une forme d’impartialité. Il tend à rejeter l’inspiration des muses prônée par le romantisme pour donner toute son importance à l’écriture, au style plus exactement (ce que Roland Barthes, dans Le Degré zéro de l’écriture, formule en ces termes : « La valeur-travail remplace un peu la valeur-génie »).
Dans une lettre à Louise Colet (femme de lettres, poète), datée du 18 aout 1846, Flaubert écrit : « Tu prendras en pitié l’usage de se chanter soi-même. Cela réussit une fois, dans un cri, mais quelque lyrisme qu’ait Byron, par exemple, Shakespeare l’écrase à côté avec son impersonnalité surhumaine… L’artiste doit s’arranger de façon à faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu ».
D’autre part, pour Gustave Flaubert, cette « impersonnalité » de l’artiste doit s’associer à la « précision des sciences physiques ». L’art, pour l’auteur de Madame Bovary, répond à l’exigeante association du Beau et du Vrai. Il hérite cette vision de la conception classique de Boileau qu’il admirait (« Rien n’est beau que le vrai : le vrai seul est aimable », écrit l’homme de lettres du Grand siècle dans son épître IX). Flaubert, quant à lui, écrit dans une lettre (à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, le 18 mars 1857) :
L’artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu’on le sente partout, mais qu’on ne le voie pas. Et puis, l’Art doit s’élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques ! La difficulté capitale, pour moi, n’en reste pas moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon.
Ainsi, pour tous ces romanciers, la revendication de la conformité au réel passe avant tout par un rejet des formes convenues de la fiction (les « romans de femme de chambre », dit Stendhal). L’idée selon laquelle le réalisme est une copie conforme de la réalité est erronée. Ce réalisme-là a été au contraire délaissé plus tard par Stendhal ou Balzac, et vivement rejeté encore par Flaubert, qui affirme : « J’exècre ce qu’on est convenu d’appeler le réalisme, bien qu’on m’en fasse un des pontifes » (lettre à George Sand, 6 février 1876).
De fait, ces romanciers se veulent avant tout artiste et ne sont pas ignorants du fait que « l’illusion de la vie est une constante du genre romanesque », comme le formule le critique littéraire Vincent Jouve.
Le naturalisme ira, pour sa part, davantage en ce sens, adoptant une méthode expérimentale de l’écriture, fondée sur une documentation minutieuse et une observation quasi chirurgicale de ce qui constitue la réalité (qu’il s’agisse de classes sociales, de psychologie humaine, de monuments, etc.). Emile Zola est la figure de proue de ce mouvement hérité du réalisme.
Néanmoins, on ne peut le limiter, comme on l’a fait des réalistes, à la simple dissection scolaire de la réalité rendue sur papier. Ce qui, pour Zola, compte, c’est l’art de faire accepter au public une vision pourtant personnelle du monde (c’est ce qu’exprime Maupassant lorsqu’il classe l’écrivain dans la grande catégorie des Illusionnistes).
J’agrandis, cela est certain ; mais je n’agrandis pas comme Balzac, pas plus que Balzac n’agrandit comme Hugo. Tout est là, l’œuvre est dans les conditions de l’opération. Nous mentons tous plus ou moins, mais quelle est la mécanique et la mentalité de notre mensonge ? Or – c’est ici que je m’abuse peut-être – je crois encore que je mens pour mon compte dans le sens de la vérité. J’ai l’hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l’observation exacte. La vérité monte d’un coup d’aile jusqu’au symbole.
Zola, Lettre à Henry Céard, 22 mars 1885
Principes littéraires du réalisme
Le réalisme repose sur les grands principes suivants :
- L’objet principal du roman est la réalité, la vie quotidienne sous toutes ses formes, la société dans ce qu’elle a à la fois de plus glorieux et de plus misérable.
- Le rejet de toutes les formes d’idéalisation de la réalité, on délaisse certaines formes littéraires et le roman prend un nouvel essor.
- Analyser les comportements humains, les mœurs, les mécanismes sociaux et politiques, en adoptant le point de vue d’un observateur (voire d’un documentaliste).
- L’effacement de l’auteur et l’impersonnalité sont de mise : on rejette les épanchements lyriques dont faisaient montre les romantismes.
Extraits d’auteurs réalistes
Le Rouge et le Noir (1830) de Stendhal
Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d’entrée la figure d’un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette.
Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu romanesque de Mme de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d’entrée, et qui évidemment n’osait pas lever la main jusqu’à la sonnette. Mme de Rênal s’approcha, distraite un instant de l’amer chagrin que lui donnait l’arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s’avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit tout près de l’oreille:
– Que voulez-vous ici, mon enfant?
Julien se tourna vivement, et, frappé du regard si rempli de grâce de Mme de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu’il venait faire. Mme de Rénal avait répété sa question.
– Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu’il essuyait de son mieux.
Mme de Rênal resta interdite, ils étaient fort près l’un de l’autre à se regarder. Julien n’avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler d’un air doux. Mme de Rênal regardait les grosses larmes qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles d’abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d’une jeune fille, elle se moquait d’elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c’était là ce précepteur qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants !
Stendhal, Le Rouge et le Noir
Eugénie Grandet (1842-1848), de Balzac
Il n’allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner ; il ne faisait jamais de bruit, et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier perçaient, surtout quand il était au logis, où il se contraignait moins que partout ailleurs.
Au physique, Grandet était un homme de cinq pieds, trapu, carré, ayant des mollets de douze pouces de circonférence, des rotules noueuses et de larges épaules ; son visage était rond, tanné, marqué de petite vérole ; son menton était droit, ses lèvres n’offraient aucunes sinuosités, et ses dents étaient blanches ; ses yeux avaient l’expression calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic ; son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérances significatives ; ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blanc et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d’une plaisanterie faite sur monsieur Grandet. Son nez, gros par le bout, supportait une loupe veinée que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice.
Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur, l’égoïsme d’un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l’avarice et sur le seul être qui lui fût réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Attitude, manières, démarche, tout en lui, d’ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l’habitude d’avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs faciles et molles en apparence, monsieur Grandet avait-il un caractère de bronze. Toujours vêtu de la même manière, qui le voyait aujourd’hui le voyait tel qu’il était depuis 1791.
Balzac, Eugénie Grandet
Madame Bovary (1856), de Flaubert
Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche ; ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s’éteignent, à la croire déjà morte, sans l’effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux, comme si l’âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s’agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s’était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l’appartement. Charles était de l’autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur, comme au contrecoup d’une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l’ecclésiastique précipitait ses oraisons ; elles se mêlaient aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines, qui tintaient comme un glas de cloche.
Flaubert, Madame Bovary
Une vie (1883), de Maupassant
Elle se demanda ce qu’elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains. Elle n’avait point envie de redescendre au salon auprès de sa mère qui sommeillait ; et elle songeait à une promenade, mais la campagne semblait si triste qu’elle sentait en son cœur, rien qu’à la regarder par la fenêtre, une pesanteur de mélancolie.
Alors elle s’aperçut qu’elle n’avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. Toute sa jeunesse au couvent avait été préoccupée de l’avenir, affairée de songeries. La continuelle agitation de ses espérances emplissait, en ce temps-là, ses heures sans qu’elle les sentît passer. Puis, à peine sortie des murs austères où ses illusions étaient écloses, son attente d’amour se trouvait tout de suite accomplie. L’homme espéré, rencontré, aimé, épousé en quelques semaines, comme on épouse en ces brusques déterminations, l’emportait dans ses bras sans la laisser réfléchir à rien.
Mais voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l’inconnu. Oui, c’était fini d’attendre.
Alors plus rien à faire, aujourd’hui, ni demain ni jamais. Elle sentait tout cela vaguement à une certaine désillusion, à un affaissement de ses rêves.
Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, après avoir regardé quelque temps le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir.
Étaient-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu’au mois de mai ? Qu’étaient donc devenues la gaieté ensoleillée des feuilles, et la poésie verte du gazon où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, où frétillaient, comme au bout de fils invisibles, les fantasques papillons jaunes ? Et cette griserie de l’air chargé de vie, d’arômes, d’atomes fécondants n’existait plus.
Les avenues, détrempées par les continuelles averses d’automne, s’allongeaient, couvertes d’un épais tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. Les branches grêles tremblaient au vent, agitaient encore quelque feuillage prêt à s’égrener dans l’espace. Et sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et triste à faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à de larges sous d’or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient.
Maupassant, Une vie, Chapitre 6
Prolongez votre lecture en découvrant les principaux mouvements littéraires de l’histoire de la littérature.