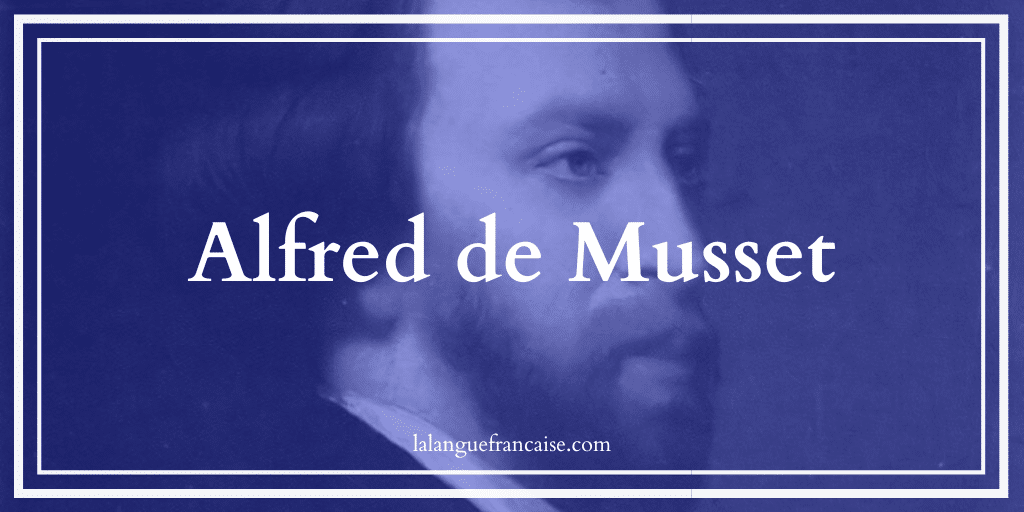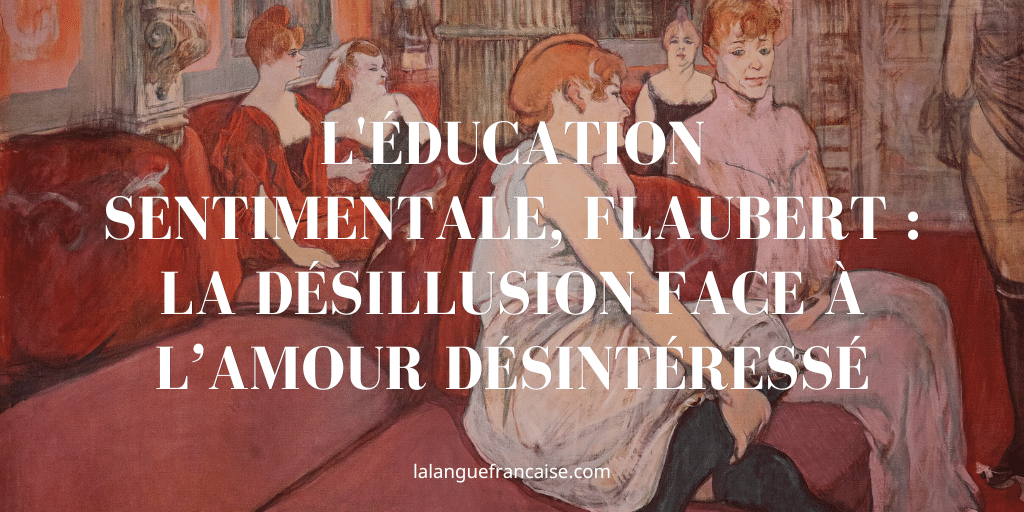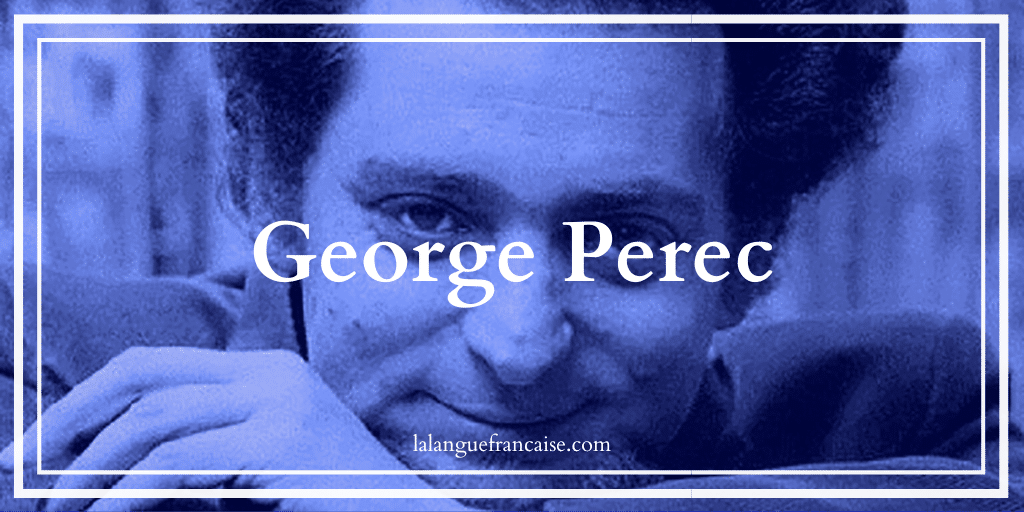Stéphane Mallarmé (1842-1898) : vie et œuvre
Sommaire

Un « homme d’intérieur », c’est ainsi que le décrit Paul Claudel. Casanier, discret, Stéphane Mallarmé a vécu une vie plus tranquille, à l’exact opposé des poètes et écrivains de sa génération dont il a croisé la route : Rimbaud, Verlaine, Catulle Mendès, Villiers de l’Isle Adam…
Homme d’intérieur, Mallarmé l’a aussi été dans sa pratique poétique : en tant que chef de file du mouvement symboliste, sa conception du langage s’approche de la métaphysique (telle que développée plus tard par Heidegger). Ainsi, à ses yeux, la poésie a partie liée avec « l’énigme » (des années après, Sartre se rapproche de cette vision en parlant d’un langage polysémique et d’une ressemblance « magique » entre signifiant et signifié, dans Qu’est-ce que la littérature ?, en 1948).
Si la vie de Stéphane Mallarmé ne se démarque pas par ses excès et comporte peu d’incidents notable, son œuvre le propulse sur le devant de la scène littéraire et fait de lui l’un des poètes les plus importants de la fin du siècle. Il est d’ailleurs sacré, à la mort de Verlaine et à sa suite, « Prince des poètes ».
Qui est Mallarmé ?
Stéphane Mallarmé naît à Paris, le 18 mars 1842, sous le prénom d’Étienne. Il perd sa mère à l’âge de cinq ans. Son père, Numa Mallarmé, fonctionnaire, se remarie l’année suivante. L’enfance de Stéphane Mallarmé est tranquille : avec sa sœur cadette Maria, il est élevé par ses grands-parents, avant d’être mis en pension à l’âge de huit ans. À l’école, il ne fait pas preuve d’une grande aptitude scolaire, mis à part pour les langues.
Stéphane Mallarmé est un enfant taciturne, rêveur, solitaire. Il révèle une « âme lamartinienne » comme il le dit lui-même plus tard. À l’été 1857, il est profondément marqué par le décès de Maria à l’âge de treize ans, dont il était très proche. La perte de cette unique sœur contribue certainement à l’éclosion de sa vocation poétique et le hantera toute sa vie (les thèmes de la figure féminine et de la mort sont très présents dans ses poèmes).
Mallarmé écrit déjà depuis son plus jeune âge et lit beaucoup (Charles Saint-Beuve, Victor Hugo, Edgar Poe – il apprend l’anglais pour lire Poe dans le texte et traduire plus tard ses poèmes en français), mais c’est la découverte, en 1861, de Baudelaire et des Fleurs du Mal qui le touche plus particulièrement. Il tombe sous le charme du dandy et s’inspire de son art pour composer ses premiers poèmes.
L’année 1862 constitue un second tournant dans la vie du futur poète. Après ses études secondaires, il fait la connaissance d’Emmanuel Des Essarts, professeur de lettres et poète, grâce auquel il est intégré dans les milieux littéraires de la capitale. Il rencontre aussi le poète Henri Cazalis avec lequel il entretient par la suite une longue correspondance. C’est aussi durant cette année qu’il fait paraître ses premiers poèmes (Le Guignon, Le Sonneur). La plume de Mallarmé y est encore fortement sous influence hugolienne et baudelairienne :
Cependant que la cloche éveille sa voix claire
A l’air pur et limpide et profond du matin
Et passe sur l’enfant qui jette pour lui plaire
Un angelus parmi la lavande et le thym,
Le sonneur effleuré par l’oiseau qu’il éclaire,
Chevauchant tristement en geignant du latin
Sur la pierre qui tend la corde séculaire,
N’entend descendre à lui qu’un tintement lointain.
Je suis cet homme. Hélas ! de la nuit désireuse,
J’ai beau tirer le câble à sonner l’Idéal,
De froids péchés s’ébat un plumage féal,
Et la voix ne me vient que par bribes et creuse !
Mais, un jour, fatigué d’avoir enfin tiré,
Ô Satan, j’ôterai la pierre et me pendrai.
Stéphane Mallarmé, Le Sonneur
La même année, il part en Angleterre y enseigner l’anglais avec Maria Gerhard qu’il a rencontré peu avant, et qu’il appelle la « gentille Allemande ». Il l’épouse en 1863. Mais Mallarmé a déjà d’autres obsessions en tête que les contingences et obligations du quotidien. Lors de son séjour en Angleterre, il Compose Les Fenêtres, un poème dans lequel il fait une sorte de profession de foi idéaliste et, dans une lettre à Henri Cazalis à laquelle il joint le poème, il écrit :
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Si le Rêve était ainsi défloré et abaissé, où donc nous sauverions-nous, nous autres malheureux que la terre dégoûte et qui n’avons que le Rêve pour refuge ? O mon Henri, abreuve-toi de l’Idéal. Le bonheur d’ici-bas est ignoble – il faut avoir les mains bien calleuses pour le ramasser… Il ne faut pas voir au-dessus de ce plafond de bonheur le ciel de l’Idéal, ou fermer les yeux après.
On saisit aussi, dans ce poème, ce que deviendra pour Mallarmé le symbolisme. Sa première strophe : « Las du triste hôpital et de l’encens fétide / Qui monte en la blancheur banale des rideaux / Vers le grand crucifix ennuyé du mur vide, / Le moribond, parfois, redresse son vieux dos, » fait écho à un quatrain des Phares de Baudelaire, qui lui inspire l’idée du symbolisme :
Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures
Et d’un grand crucifix décoré seulement,
Où la prière en pleurs s’exhale des ordures
Et d’un rayon d’hiver traversé brusquement
Baudelaire, Phares
Durant les années suivantes, Mallarmé poursuit sa carrière de professeur qui lui laisse le loisir de se consacrer à la poésie. Il est professeur d’anglais à Tournon de 1863 à 1865, puis à Besançon en 1866 et à Avignon en 1867. Il est néanmoins rebuté par la monotonie de la tâche, et perd rapidement son intérêt pour le métier. Dans sa correspondance, il commente ses supérieurs : « Ces misérables qui me paient au collège ont saccagé mes plus belles heures ».
Mallarmé ne trouve aucune félicité dans sa vie quotidienne, même lorsque son foyer fête la naissance de sa fille Geneviève, en 1964. Il se réfugie presque par élan de désespoir dans la poésie. Il rencontre les écrivains Théodore Aubanel, Mistral, Catulle Mendès, Auguste Villiers de l’Isle-Adam… mais mène pour sa part une vie « dénuée d’anecdotes ».
En 1866, Mallarmé publie quelques poèmes dans le Parnasse contemporain, mais cherche déjà à dépasser cette vision de la poésie pour se tourner vers de nouvelles formes. C’est ainsi qu’il se lance dans l’écriture d’Hérodiade, un drame lyrique qu’il n’achèvera jamais, et L’Après-midi d’un Faune, publié en 1876.
En 1871, il est nommé professeur à Paris (son fils Anatole voit le jour la même année) et s’installe rue de Rome où, à partir de 1880, il reçoit tous les mardis soir ses amis, puis les adeptes du symbolisme.
La consécration du poète
Après avoir publié quelques poèmes (Toast funèbre, en mémoire de Théophile Gautier, et Le Tombeau d’Edgar Poe), dans lesquels Mallarmé explore l’hermétisme (référence à Hermès trismégiste, une écriture ésotérique qui cultive le mystère) sans pour autant connaître un grand succès, le poète se voit consacré en 1884.
La même année, Verlaine, qui le cite dans Les Poètes maudits et Huysmans qui en fait une référence de Jean Des Esseintes dans À Rebours, lui font connaître une renommée et une reconnaissance immédiates. Son nom et son œuvre sont révélés au public lettré de la capitale. Le salon de Mallarmé voit défiler de grands noms durant les soirées du mardi : Jules Laforgue, Henri de Régnier, Maurice Barrès, Paul Claudel, André Gide, Paul Valéry…
En 1887, malgré les critiques sarcastiques des journalistes qui épinglent une poésie obscure et son écriture hyperbolique, Mallarmé rassemble la quasi-totalité de ses poèmes dans un recueil, Poésies. On y trouve par exemple ses premiers poèmes, dont Azur (« De l’éternel Azur la sereine ironie »), mais aussi le Sonnet en X (« Ses purs ongles très hauts »).
En 1897, Mallarmé réunit sous le titre Divagations plusieurs réflexions sur la nature de la poésie. Il pousse plus avant sa conception d’une poésie hermétique et symboliste, et publie l’un de ses plus célèbres poèmes : Un coup de dès jamais n’abolira le hasard, où la typographie y est démantelée, les vers désaxés et présentés sous la forme d’une partition musicale. Mallarmé meurt brusquement l’année suivante en septembre 1898.
L’œuvre de Mallarmé
Porteur du courant symboliste qu’il définit dans plusieurs écrits. Il conçoit la poésie comme une « énigme » et critique les Parnassiens : « Nommer un objet, c’est supprimer les trois-quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou inversement choisir un objet et en dégager un état d’âme par une série de déchiffrement » (échange avec le journaliste Jules Huret, L’Echo, Paris, 14 mars 1891).
Mallarmé rapproche la poésie de la musique (ce que développe plus tard Sartre en parlant de langage motivé, où le rapport entre signifiant et signifié n’est pas arbitraire, donnant naissance à un langage polysémique) et conçoit la poésie comme un renversement : la chose ou l’objet est sacrifié (car inessentiel) au profit du nom (essentiel).
Les premiers poèmes
De tous les poètes de la génération symboliste, Mallarmé fut le plus marqué par la lecture de Baudelaire. Il y trouve un écho de son déchirement intérieur entre les réalités prosaïques du quotidien et l’idéal inaccessible vers lequel il tend dans son exercice de la création poétique.
On note dans les premiers poèmes de Mallarmé la reprise de certains thèmes baudelairien, qu’il s’agisse de poèmes en vers ou en prose (sept textes durant l’année 1864). Ainsi, le poème « La Pipe » apparaît comme une variation composée autour des sujets baudelairiens que sont « l’ivresse » du tabac, la mémoire affective, le jeu entre l’ici et l’ailleurs, le chat noir… (Le texte du poème est disponible sur Wikisource).
Le poème Renouveau, toujours écrit durant cette période baudelairienne, décrit un paysage intérieur – Mallarmé sort alors une période de stérilité « curieuse », comme il le dit à son ami Cazalis en 1862 (on ne peut s’empêcher de penser au « Spleen » de Baudelaire) :
Le printemps maladif a chassé tristement
L’hiver, saison de l’art serein, l’hiver lucide,
Et, dans mon être à qui le sang morne préside
L’impuissance s’étire en un long bâillement.
Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne
Qu’un cercle de fer serre ainsi qu’un vieux tombeau
Et triste, j’erre après un rêve vague et beau,
Par les champs où la sève immense se pavane
Puis je tombe énervé de parfums d’arbres, las,
Et creusant de ma face une fosse à mon rêve,
Mordant la terre chaude où poussent les lilas,
J’attends, en m’abîmant que mon ennui s’élève…
– Cependant l’Azur rit sur la haie et l’éveil
De tant d’oiseaux en fleur gazouillant au soleil.
Mallarmé, Renouveau
La poésie pure
À partir de 1870, Mallarmé se détache peu à peu des Parnassiens et de la conception classique de la poésie pour se tourner vers une vision métaphysique de cette dernière. La lecture de Hegel le marque tout particulièrement et lui ouvre les portes de l’Être et de la Pensée, de l’Absolu et du Néant.
La pratique poétique devient alors une tâche laborieuse. Abandonnant un idéal romantique qu’il sait ne pouvoir atteindre, il se tourne vers l’idéalité pure. « L’oeuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l’initiative des mots », écrit-il, comme une loi absolue dont il ne veut pas défier.
La composition de ses deux vastes ensemble poétiques que sont Hérodiade et L’Après-midi d’un Faune (qui a inspiré à Debussy sont Prélude, soulignant les liens qui unissent la poésie symboliste et une musique impressionniste, telle qu’elle est aussi explorée par Ravel ou Scriabine) confirment chez Mallarmé son évolution vers une écriture poétique hermétique.
Dans l’hermétisme mallarméen, le symbole devient hyperbole. Dans la Prose pour des Esseintes (1885), Mallarmé va au-delà du langage. Ce poème en octosyllabes dénote bien l’élan du poète dont l’acte de création se caractérise par le fait d’abandonner les contingences et l’apparence pour atteindre à ce qui est nécessaire, mais caché.
Mallarmé cherche l’essence, comme l’illustre cette réflexion tirée de la Préface du Traité du Verbe de René Ghil (1886) : « Je dis une fleur ! et… musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets ».
La poésie mallarméenne, enfin, est une poésie de l’absence, du vide, de l’inanité, de ce qui est aboli enfin. Mallarmé atteint le point d’orgue de sa création poétique avec Un coup de dès jamais n’abolira le hasard…, ultime étape de sa quête de la mise en forme d’une pensée aux prises avec le chaos de l’univers.
Dans une lettre à André Gide, en 1897, il commente son propre poème : « Le rythme d’une phrase ou même d’un objet n’a de sens que s’il les imite, et, figuré sur le papier, repris par la lettre à l’estampe originale, n’en sait rendre, malgré tout, quelque chose. » Le grand poète de la rue de Rome meurt l’année suivante et nous laisse avec le dernier trait de ce poème : « Rien n’aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation ».