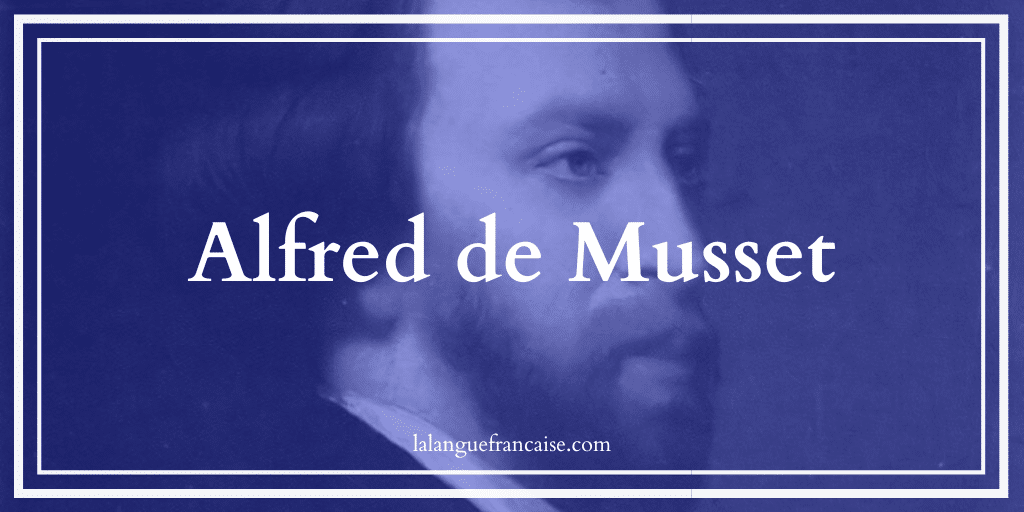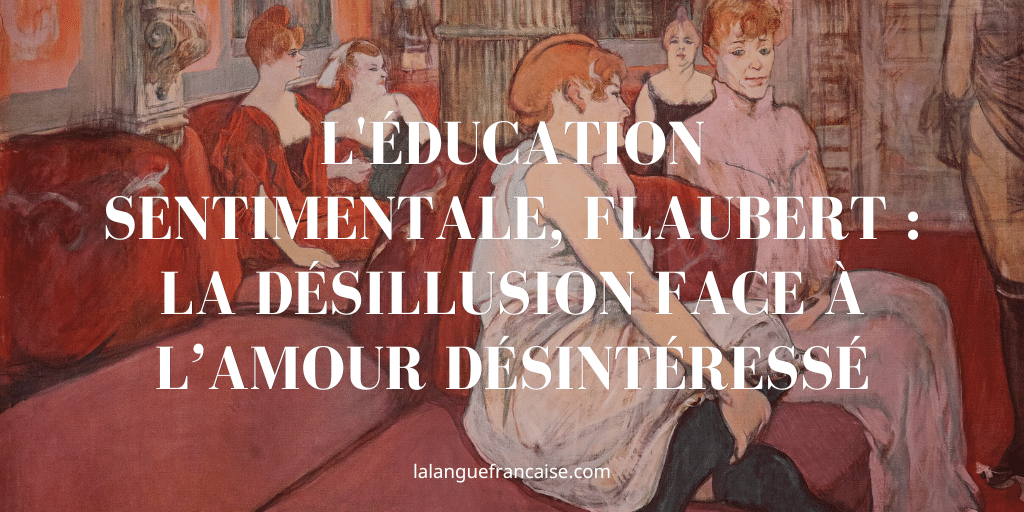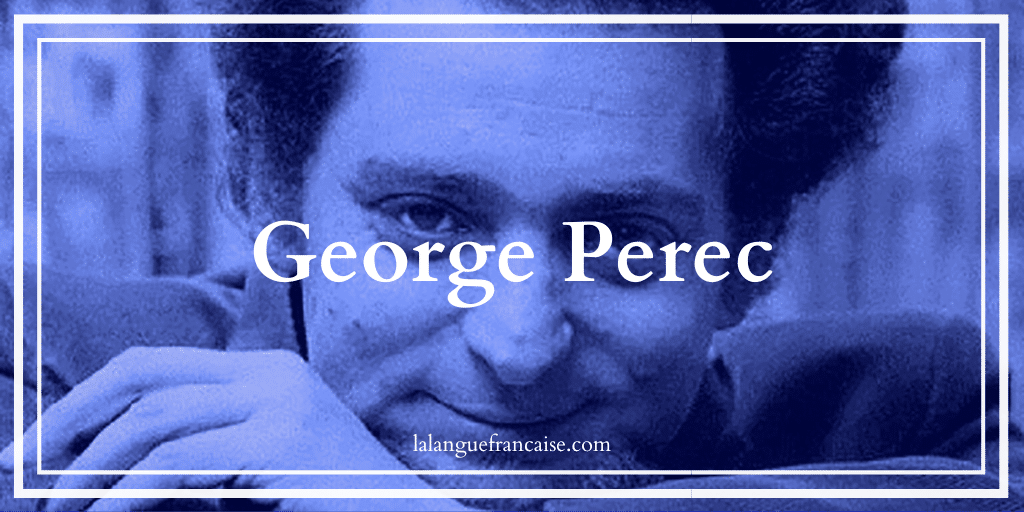Le Parnasse (XIXe siècle)
Sommaire
« Sculpteur, cherche avec soin, en attendant l’extase / un marbre sans défaut pour en faire un beau vase » écrit Théodore de Banville dans son recueil Les Stalactites. Le poète fait partie du Parnasse, mouvement poétique éclectique né à rebours du romantisme (tout comme ce dernier était né contre le classicisme). Ce mouvement littéraire se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle et rassemble de grands noms de la littérature française, de Théophile Gautier à Baudelaire.
Après « l’art pour l’art » de Théophile Gautier, les premiers poètes à rejoindre le mouvement se rassemblent autour de Leconte de Lisle, véritable porte-étendard du Parnasse. Ils font de la forme une priorité, balayant d’un revers de la main les effusions individuelles et les engagements sociaux et politiques. L’Art devient une religion, le formalisme poétique leur ligne de conduite. Ces convictions nécessitent une discipline dans l’écriture et une indifférence face à la réception des ouvrages, puisque le poète doit avoir pour unique satisfaction la contemplation du beau.
Ces dévots de la forme poétique ont emprunté leur nom au mont Parnasse, situé en Grèce, non loin de Delphes (le quartier Montparnasse à Paris, tire lui aussi son nom de cette montagne grecque).

Le mont Parnasse est, dans l’Antiquité, considéré comme le séjour des poètes, la maison de la poésie (comme le représente la fresque peinte par Raphaël, réalisée de 1509 à 1511). Ce mont est le siège d’Apollon, dieu du soleil et de la poésie, ainsi que de ses neuf Muses. Il n’est donc pas de référence plus sacrée et honorable pour les membres de ce mouvement littéraire qui s’en réclament.
Origines du Parnasse
Contexte historique
L’histoire littéraire est une suite d’actions et de réactions, de courants et de contre-courants, d’institutions et d’anti-institutions. Le Parnasse ne fait pas exception dans cette suite hégélienne. Ce mouvement poétique porté par des auteurs du milieu du XIXe siècle naît en réaction au romantisme. En 1860, Alphonse de Lamartine (1790-1869) publie son premier recueil, Les Méditations poétiques. Dans la Préface, il affirme :
Je suis le premier qui ai fait descendre la poésie du Parnasse, et qui ai donné à ce qu’on nommait la muse, au lieu d’une lyre à sept cordes de convention, les fibres mêmes du cœur de l’homme, touchées et émues par les innombrables frissons de l’âme et de la nature.
Alphone de Lamartine, Les Méditations poétiques, Préface
Les romantiques ont fait descendre la poésie du mont où elle était née, les Parnassiens n’auront de cesse de vouloir l’y replacer, considérant que le romantisme et ses excès lyriques pratiqués par la génération précédente sont passés de date.
Cette réaction tient aussi d’une volonté de ne pas laisser la littérature devenir un moyen de véhiculer des idées morales, politiques ou sociales, à une époque où les Français subissent un certain désenchantement vis-à-vis de la chose politique.
Les figures de proue du Parnasse
Deux figures importantes de la poésie française encadrent le mouvement du Parnasse. Tout d’abord, Théophile Gautier (1811-1872), véritable précurseur du mouvement, qui condense dans la Préface de Mademoiselle de Maupin, roman épistolaire publié en 1835, toute la doctrine du Parnasse avant même la véritable naissance du mouvement.
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. […] Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin.
Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Préface
Dans les années 1830, le poète avait été un fervent soutien du romantisme, mais au tournant du siècle, Gautier réagit vivement aux épanchements du mouvement romantique en devenant le chef de file de « l’école de l’Art », notamment avec la publication, en 1852, de son recueil Émaux et Camées, dans lequel il met en application les principes que suivront par la suite les Parnassiens.
Ses poèmes à mètres courts sont en effet des bijoux ciselés, travaillés avec une infinie précision plasticienne et technique. On y retrouve l’intérêt que portait Théophile Gautier à la poésie descriptive et son goût du pittoresque et de la « couleur locale » :
Dans le fronton d’un temple antique,
Théophile Gautier, Dans le fronton d’un temple antique
Deux blocs de marbre ont, trois mille ans,
Sur le fond bleu du ciel attique,
Juxtaposé leurs rêves blancs ;
En 1856, Théophile Gautier déclare : « Nous croyons à l’autonomie de l’art ; l’art pour nous n’est pas le moyen, mais le but […]. Une belle forme est une belle idée, car que serait-ce qu’une forme qui n’exprimerait rien ? » (L’Artiste).
Plus tard, en septembre 1857, alors que Madame Bovary de Gustave Flaubert vient de paraître, sommet du roman réaliste – mouvement romanesque né des cendres du romantisme –, Théophile Gautier publie un poème-manifeste, intitulé « Art », dans la revue L’Artiste. La rupture avec le romantisme est consommée et Théophile Gautier fait de ce poème l’illustration de la devise du Parnasse : « L’art pour l’art ».
Oui, l’oeuvre sort plus belle
Théophile Gautier, Art
D’une forme au travail
Rebelle,
Vers, marbre, onyx, émail.
Point de contraintes fausses !
Mais que pour marcher droit
Tu chausses,
Muse, un cothurne étroit.
À la suite de Théophile Gautier, plusieurs auteurs se révèlent sensibles à cette conception de la poésie. Notamment Leconte de Lisle (1818-1894), grâce auquel la poésie évolue de « l’art pour l’art » à la concrétisation du Parnasse.
Cet érudit helléniste (il est aussi l’auteur d’une traduction de l’Odyssée) et hindoue, a le regard fixé sur le mont Parnasse. Selon lui, la poésie doit être conçue à la lumière de l’intelligence et de la culture, ne se fixant pour aucun autre objectif que la recherche de la beauté, qu’il établit comme une forme de religion.
Poursuivant un culte de la perfection formelle tout en restant attaché à la véracité historique, Leconte de Lisle puise son inspiration dans les récits de la Grèce antique (il publie en 1852 Les Poèmes antiques), mais se permet aussi d’emprunter aux natures exotiques, aux peuples indigènes, des images dont il se nourrit pour faire de ses poèmes de véritables tableaux. Comme c’est le cas dans son recueil Les Poèmes barbares, publié en 1872 :
Tel qu’un morne animal, meurtri, plein de poussière,
Leconte de Lisle, Les Poèlmes barbares, Les Montreurs
La chaîne au cou, hurlant au chaud soleil d’été,
Promène qui voudra son coeur ensanglanté
Sur ton pavé cynique, ô plèbe carnassière !
Leconte de Lisle, en tentant de concilier l’art et la science, enrichit le mouvement d’un apport positiviste. Fils d’un planteur créole, il avait lui aussi été séduit par le romantisme, mais les événements de juin 1848 (révoltes des ouvriers parisiens) achèvent de le séparer de tout engagement politique. Il devient un « abstentionniste de l’histoire » et préfère voir dans le poète celui qui « réalise le Beau dans la mesure de ses forces et de sa vision interne par la combinaison complexe, savante, harmonique, des lignes, des couleurs, et des sons ».
Le club des Parnassiens
De mars à juin 1866, l’éditeur Alphonse Lemerre publie une série de dix-huit brochures intitulées Le Parnasse contemporain. C’est autour de ces publications que se regroupent les poètes qu’on baptisera les Parnassiens. On y compte de grands poètes, considérés comme les chefs de file du mouvement (dont Leconte de Lisle que nous avons déjà cité) :
- Théodore de Banville (1823-1891), considéré comme un maître du Parnasse, avec Les Stalactites (1846) et les Odes funambulesques (1857). Il vient lui aussi du romantisme et si l’on a fustigé chez l’aspect « rimailleur » de sa poésie, Baudelaire lui reconnaît une « certitude dans l’expression lyrique » :
Au moment de jeter dans le flot noir des villes
Théodore de Banville, Dernière angoisse
Ces choses de mon coeur, gracieuses ou viles,
Que boira le gouffre sans fond,
Ce gouffre aux mille voix où s’en vont toutes choses,
Et qui couvre d’oubli les tombes et les roses,
Je me sens un trouble profond.
On ressent aussi dans la poésie de Banville un aspect moins souligné que le culte de la forme et pourtant constitutif du Parnasse : il s’agit d’un certain pessimisme qui émerge entre les lignes, la mélancolie d’un idéal perdu, la tristesse exprimée face à la faillite des vieux rêves (auxquels les poètes font référence en se servant des thèmes de l’Antiquité grecque ou des mythologies diverses). On sent d’ores et déjà poindre le désespoir de l’âme moderne, l’appel d’une mort considérée comme libératrice.
- José Maria de Heredia (1842-1905). Lui aussi considéré comme un maître chez les Parnassiens, il fait partie des plus ardent disciples de Leconte de Lisle, le « plus sûr gardien de la doctrine formaliste et parnassienne » (Lagarde). En 1893, il publie Les Trophées, recueil de 118 sonnets, dans lequel il fait de cette forme poétique un sommet de la littérature. On y décèle « splendeur lexicale, rythmes saisissants, chutes impressionnantes » (Lagarde) :
Le choc avait été très rude. Les tribuns
José Maria de Heredia, Soir de bataille
Et les centurions, ralliant les cohortes,
Humaient encor dans l’air où vibraient leurs voix fortes
La chaleur du carnage et ses âcres parfums.
D’un œil morne, comptants leurs compagnons défunts,
Les soldats regardaient, comme des feuilles mortes,
Au loin, tourbillonner les archers des Phraortes ;
Et la sueur coulait de leurs visages bruns. […]
D’autres poètes, moins connus aujourd’hui, mais ayant acquis une certaine notoriété à l’époque, s’ajoutent à cette galerie parnassienne :
- Sully Prudhomme (1839-1907), avec Solitudes (1869)
- François Coppée (1842-1908), avec Le Reliquaire (1866), Les Intimités (1868) et Promenades et intérieurs (1872)
- Catulle Mendès (1841-1909), avec Hespérus (1869) et Soirs moroses (1876)
- Léon Dierx (1838-1912), avec Aspirations poétiques (1858) et Lèvres closes (1867)
Tous ces poètes se sont regroupés autour d’une idée principale : la loi de la forme et l’exigence du Beau. Et si certains de ces poètes se sont laissés aller à un didactisme, à un documentalisme ou encore à une forme de moralisme poétique, d’autres ont annoncé l’arrivée du symbolisme et des modernes que sont Verlaine, Mallarmé, mais surtout Baudelaire avant ça, qui dire que « la moralité d’une oeuvre, c’est sa beauté ».
Baudelaire, qui se nourrit tout à la fois du romantisme, puis du Parnasse, sans jamais en faire vraiment partie, rend hommage à Théodore de Banville dans un poème publié en 1857 (« À Théodore de Banville », écrit en 1842) dans son recueil Les Fleurs du mal :
Vous avez empoigné les crins de la Déesse
Baudelaire, Les Fleurs du mal, À Théodore de Banville
Avec un tel poignet, qu’on vous eût pris, à voir
Et cet air de maîtrise et ce beau nonchaloir,
Pour un jeune ruffian terrassant sa maîtresse.
L’œil clair et plein du feu de la précocité,
Vous avez prélassé votre orgueil d’architecte
Dans des constructions dont l’audace correcte
Fait voir quelle sera votre maturité.
Poëte, notre sang nous fuit par chaque pore ;
Est-ce que par hasard la robe de Centaure,
Qui changeait toute veine en funèbre ruisseau,
Était teinte trois fois dans les baves subtiles
De ces vindicatifs et monstrueux reptiles
Que le petit Hercule étranglait au berceau ?
Principes du Parnasse
Si le Parnasse devait tenir en deux caractéristiques, elles seraient résumées dans le besoin d’une perfection formelle et d’un lyrisme impersonnel, comme le formule Théophile Gautier, dans Rapport sur les progrès de la poésie :
Le poète devrait voir les choses humaines comme les verrait un dieu du haut de son Olympe ; les réfléchir sans intérêt dans ses vagues prunelles et leur donner, avec un détachement parfait, la vie supérieure de la forme.
Théophile Gautier, Rapport sur les progrès de la poésie
La poésie parnassienne se veut objective, purgée de tout épanchement personnel. Elle veut se défaire des excès passionnés tout en conservant une parole lyrique. Le poète est un passeur. A cela s’ajoute l’aspect érudit de cette poésie descriptive, pittoresque, exotique, précise, historique, archéologique.
Nous pouvons citer quatre convictions que partageait le cercle du Parnasse et qui se sont imposées en grande partie en réaction face au romantisme, tout en conservant pour ce mouvement un certain attachement :
- Une poésie qui va contre l’excès du Moi, refus de l’expression des sentiments personnels et le besoin d’une impersonnalité dans l’expression ;
- La nécessité d’un culte de la beauté qui passe par un travail rigoureux de la forme et le refus de la facilité et des licences ;
- Les poètes sont contre la contingence et l’artificiel et affichent un intérêt marqué pour l’histoire, l’Antiquité, l’Orient, l’architecture ou la sculpture ;
- Le Parnasse rejette l’engagement politique et social et prône une prudence, une hauteur vis-à-vis des événements.
Extraits d’auteurs Parnassiens
Voici une sélection d’extraits tirés des œuvres, majoritairement poétiques, appartenant aux principaux auteurs Parnassiens (aussi disponibles sur Wikisource).
Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. — On supprimerait les fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériellement ; qui voudrait cependant qu’il n’y eût plus de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu’aux roses, et je crois qu’il n’y a qu’un utilitaire au monde capable d’arracher une plate-bande de tulipes pour y planter des choux.
À quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des économistes.
À quoi bon la musique ? à quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Mozart à M. Carrel, et Michel-Ange à l’inventeur de la moutarde blanche ?
Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. — L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines.
Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Préface
Le thème personnel et ses variations trop répétées ont épuisé l’attention ; l’indifférence s’en est suivie à juste titre ; mais s’il est indispensable d’abandonner au plus vite cette voie étroite et banale, encore ne faut-il s’engager en un chemin plus difficile et dangereux, que fortifié par l’étude et l’initiation. Ces épreuves expiatoires une fois subies, la langue poétique une fois assainie, les spéculations de l’esprit, les émotions de l’âme, les passions du cœur, perdront-elles de leur vérité et de leur énergie, quand elles disposeront de formes plus nettes et plus précises ? Rien, certes, n’aura été délaissé ni oublié ; le fonds pensant et l’art auront recouvré la sève et la vigueur, l’harmonie et l’unité perdues. Et plus tard, quand les intelligences profondément agitées se seront apaisées, quand la méditation des principes négligés et la régénération des formes auront purifié l’esprit et la lettre, dans un siècle ou deux, si toutefois l’élaboration des temps nouveaux n’implique pas une gestation plus lente, peut-être la poésie redeviendra-t-elle le verbe inspiré et immédiat de l’âme humaine. En attendant l’heure de la renaissance, il ne lui reste qu’à se recueillir et à s’étudier dans son passé glorieux.
L’art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l’intelligence, doivent donc tendre à s’unir étroitement, si ce n’est à se confondre. L’un a été la révélation primitive de l’idéal contenu dans la nature extérieure ; l’autre en a été l’étude raisonnée et l’exposition lumineuse. Mais l’art a perdu cette spontanéité intuitive, ou plutôt il l’a épuisée ; c’est à la science de lui rappeler le sens de ses traditions oubliées, qu’il fera revivre dans les formes qui lui sont propres.
Leconte de Lisle, Poèmes antiques, Préface
Sous les noirs acajous, les lianes en fleur,
Dans l’air lourd, immobile et saturé de mouches,
Pendent, et, s’enroulant en bas parmi les souches,
Bercent le perroquet splendide et querelleur,
L’araignée au dos jaune et les singes farouches.
C’est là que le tueur de bœufs et de chevaux,
Le long des vieux troncs morts à l’écorce moussue,
Sinistre et fatigué, revient à pas égaux.
Il va, frottant ses reins musculeux qu’il bossue ;
Et, du mufle béant par la soif alourdi,
Un souffle rauque et bref, d’une brusque secousse,
Trouble les grands lézards, chauds des feux de midi,
Dont la fuite étincelle à travers l’herbe rousse.
En un creux du bois sombre interdit au soleil
Il s’affaisse, allongé sur quelque roche plate ;
D’un large coup de langue il se lustre la patte ;
Il cligne ses yeux d’or hébétés de sommeil ;
Et, dans l’illusion de ses forces inertes,
Faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs,
Il rêve qu’au milieu des plantations vertes,
Il enfonce d’un bond ses ongles ruisselants
Dans la chair des taureaux effarés et beuglants.
Leconte de Lisle, « Le rêve du jaguar », Poèmes barbares
Je suis un pâle enfant du vieux Paris, et j’ai
Le regret des rêveurs qui n’ont pas voyagé.
Au pays bleu mon âme en vain se réfugie,
Elle n’a jamais pu perdre la nostalgie
Des verts chemins qui vont là-bas, à l’horizon.
Comme un pauvre captif vieilli dans sa prison
Se cramponne aux barreaux étroits de sa fenêtre
Pour voir mourir le jour et pour le voir renaître.
Ou comme un exilé, promeneur assidu,
Regarde du coteau le pays défendu
Se dérouler au loin sous l’immensité bleue,
Ainsi je fuis la ville et cherche la banlieue.
Avec mon rêve heureux j’aime partir, marcher
Dans la poussière, voir le soleil se coucher
Parmi la brume d’or, derrière les vieux ormes,
Contempler les couleurs splendides et les formes
Des nuages baignés dans l’occident vermeil,
Et, quand l’ombre succède à la mort du soleil,
M’éloigner encor plus par quelque agreste rue
Dont l’ornière rappelle un sillon de charrue,
Gagner les champs pierreux, sans songer au départ,
Et m’asseoir, les cheveux au vent, sur le rempart.
Au loin, dans la lueur blême du crépuscule,
L’amphithéâtre noir des collines recule,
Et, tout au fond du val profond et solennel
Paris pousse à mes pieds son soupir éternel.
Le sombre azur du ciel s’épaissit. Je commence
A distinguer des bruits dans ce murmure immense,
Et je puis, écoutant, rêveur et plein d’émoi,
Le vent du soir froissant les herbes près de moi,
Et parmi le chaos des ombres débordantes,
Le sifflet douloureux des machines stridentes,
Ou l’aboiement d’un chien, ou le cri d’un enfant,
Ou le sanglot d’un orgue au lointain s’étouffant,
Ou le tintement clair d’une tardive enclume,
Voir la nuit qui s’étoile et Paris qui s’allume
François Coppée, « Un pâle enfant du vieux Paris », Les Intimités
Pas un seul bruit d’insecte ou d’abeille en maraude,
Tout dort sous les grands bois accablés de soleil
Où le feuillage épais tamise un jour pareil
Au velours sombre et doux des mousses d’émeraude.
Criblant le dôme obscur, Midi splendide y rôde
Et, sur mes cils mi-clos alanguis de sommeil,
De mille éclairs furtifs forme un réseau vermeil
Qui s’allonge et se croise à travers l’ombre chaude.
Vers la gaze de feu que trament les rayons,
Vole le frêle essaim des riches papillons
Qu’enivrent la lumière et le parfum des sèves ;
Alors mes doigts tremblants saisissent chaque fil,
Et dans les mailles d’or de ce filet subtil,
Chasseur harmonieux, j’emprisonne mes rêves.
José Maria de Heredia, « La Nature et le Rêve », Les Trophées